
Machine à multiplier de Léon Bollée
Symbole du préfixe Méga- qui multiplie par un million l'unité de mesure devant laquelle il est placée. En informatique, devant bit ou octet, il représente le facteur 1 048 576 (voir Mbit et Mo)..
Voir Macintosh.
Méthode, à l'origine française, de conception de logiciels, en particulier pour le temps réel, et développée à l'université de Carnegie-Mellon au début des années 1980. Mach a été élaboré pour supporter les fonctions multitâches et multitraitements du système qui remplacera MacOs d'Apple avec OpenStep.
machine analytique : voir Babbage
machine différentielle : voir Babbage

Machine à multiplier de Léon Bollée
Des origines très anciennes
Depuis les temps les plus anciens, l'homme a cherché un appui matériel pour effectuer ses calculs. En premier lieu, il a eu recours à des techniques élaborées utilisant les doigts (méthode "digitales"). Ensuite, il a utilisé les cailloux. Le mot calculer tire son origine du latin, "calculus". Ces cailloux, pourvus de signes distinctifs, ont pris la forme de jetons (Mésopotamie), qui sont à l'origine du calcul écrit, comme de l'écriture elle-même. Les résultats des calculs les plus courants ont ensuite été enregistrés sous forme de tableaux pour servir de modèle ("table de Pythagore" ou abaque, que Rome hérite des Orientaux et des Grecs).
Les premières machines
L'idée d'utiliser le mouvement (mécanique) pour soutenir le calcul est très ancienne (androïdes, automates). À côté du boulier (encore en usage en Russie et en Asie orientale, en particulier au Japon), on trouve, dès 70 av. J.-C., une vraie "machine à calculer" : les ingénieurs de l'époque hellénistique savaient se servir des engrenages (y compris de l'engrenage différentiel) pour déterminer les positions courantes du Soleil et de la Lune, comme le montre la découverte du "mécanisme d'Anticythère".
En Occident, en 1623, le mathématicien et théologien anglais William Oughtred, qui étudie les logarithmes, invente la règle à calcul moderne. À la même époque, Wilhelm Schickard construit le prototype d'une machine à calculer, qui, après les améliorations apportées par Pascal (voir Pascal, Blaise), en matière d'addition et de soustraction avec report, en 1642, G.W. Leibniz, pour les quatre opérations de base, en 1673 et Ph. Hahn, qui achève la machine de Leibniz en 1774, ainsi que par leurs successeurs, allait aboutir en 1821 à la production des machines à calculer mécaniques en France.
Charles Babbage (1792-1871) travailla à partir de 1833 à l'élaboration d'une machine à calculer programmable, inspirée par le métier à tisser de Joseph-Marie Jacquard (créé en 1805). Le principe des cartes perforées a également inspiré Hermann Hollerith pour sa machine électromécanique de tri et de dénombrement (voir trieuse) utilisée lors du onzième recensement américain en 1890.
D'autres chercheurs, comme K. Zuse et H. Aiken (voir Aiken, Howard), ont abouti, dans le contexte de la dernière guerre mondiale, à la réalisation de vraies machines à calculer programmables.
Vers des calculs toujours plus complexes
La nécessité de réaliser rapidement des calculs impressionnants, valable encore aujourd'hui dans certaines branches comme la météorologie, ne doit pas faire oublier que la vocation des machines à calculer n'est pas limitée au strict "calcul" (arithmétique). Depuis le génial Raymond Lulle (vers 1235-1315), précurseur médiéval avec sa "machine à penser", jusqu'aux débuts de l'intelligence artificielle, on a essayé de soumettre au traitement automatique les données les plus diverses de l'activité humaine. C'est pourquoi, en français, la modeste "calculatrice" a reçu, en prévision de ses prouesses futures, le nom d'ordinateur.
La "Machine à remonter le temps" est un logiciel éducatif multimédia. L'enfant explore le temps à travers treize époques différentes, de la préhistoire à nos jours. À chaque époque, il entre dans une maison, la visite et rencontre ses habitants. Il peut aussi écouter des sons d'époque. Un appareil photo lui permet de conserver des souvenirs de son voyage à travers les âges. Trois jeux sont également proposés, le jeu des costumes, le jeu des erreurs et le jeu du détective.
Voir Babbage, Charles.

La machine à calculer de Bollée (modèle de 1889, modifié
en 1892)
C'est à l'âge de 19 ans que Léon Bollée invente et construit la première machine arithmétique à multiplier directement (voir machine à calculer). Cette machine utilise pour cela une matérialisation de la table de Pythagore sous la forme de chevilles implantées sur des plaques métalliques. Ces chevilles agissent sur des crémaillères qui constituent l'organe multiplicateur. Contrairement aux machines procédant par additions répétées, un tour de manivelle suffit ici pour réaliser une opération.
Voir Jacquard, Joseph-Marie.
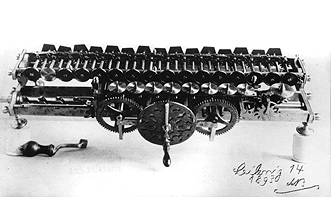
La machine à calculer de Leibniz
Dans cette machine, le nombre à multiplier peut être mémorisé mécaniquement et donc appliqué répétitivement pour réaliser les multiplications au moyen d'une manivelle. Pour effectuer cette opération, Leibniz a imaginé un tambour à dents inégales, coulissant sur un axe. Selon sa position, le tambour engage un nombre variable de cannelures dans le rouage opérateur qui exécute les calculs.
Voir machine à calculer.
Il s'agit d'une machine "abstraite" (voir abstrait), imaginée par Alan Turing en 1940. Elle est censée représenter l'ensemble des calculs que peut effectuer une machine : pourvue d'une tête de lecture et d'une tête d'écriture, elle se promène le long d'un ruban infini qui constitue la mémoire, marqué de 0 ou 1, qu'elle modifie éventuellement, et s'arrête lorsque le programme est fini.
Musicien et chercheur au Media Lab (voir MIT).

PowerMac 9500
Les Macintosh - que l'on désigne familièrement par l'abréviation "Mac" - composent une famille de micro-ordinateurs mis sur le marché par Apple en 1984. Pendant de nombreuses années, ces ordinateurs ont été caractérisés surtout par les processeurs 68000 de Motorola, ainsi que par les versions successives du premier système d'exploitation basé sur une interface utilisateur graphique évoluée et conviviale (voir GUI). Ce système d'exploitation appelé MacOs a contribué fortement au succès commercial des Mac. Sa dernière version est la version 7.5 (voir Rapsody).
Les Mac sont fréquemment utilisés dans le domaine graphique (voir infographie).
Depuis 1994, Apple utilise dans les nouveaux PowerMac des processeurs de la série PowerPC et, depuis 1996, tous les Mac sont équipés de puces Power-PC.
Nom générique donné par Apple depuis 1993 à son système d'exploitation qui tourne sur la gamme Macintosh et surtout sur PowerMac.
La version 7.0 et les suivantes ont commencé à implémenter les avantages du nouveau processeur PowerPC, mais le système n'a pleinement atteint ses ambitions que dans la mise à jour 7.5.1.
Les caractéristiques du système sont multitâches et MultiFinder : gestion des périphériques par bande d'icônes, rapidité d'exécution ; multimédia : capacités graphiques, vidéo et sonores émulées.
Les macros permettent d'exécuter des instructions et des routines récurrentes (voir routine). Lorsque l'utilisateur doit entrer une suite d'instructions de manière répétée, il peut l'enregistrer sous la forme d'une macro afin de l'utiliser comme si c'était une instruction unique.
Dans les logiciels d'application, les macros sont constituées de suites d'instructions qui sont générées par programmation ou par des actions de l'utilisateur en mode apprentissage.
Des macros peuvent également faire partie des programmes en assembleur. L'assembleur identifie les séquences de programmes prédéfinies par l'intermédiaire d'un nom d'appel et les incorpore lors de l'exécution du programme.
Voir macrocommande et macros intégrées.
Appelée également macrofonction, la macrocommande est une séquence enregistrée de commandes fréquemment utilisées, accessible au moyen d'un raccourci clavier.
Voir macrocommande.

L'une des plus grandes entreprises dans les domaines du multimédia, de la publication sur WWW et de la DAO. Elle fut créée en avril 1992 à la faveur de l'union d'Authorware et de MacroMind Paracomp. Macromedia a conçu le système de création Director et Freehand (qui fut repris par Aldus), ainsi que des programmes de traitement d'images et de gestion des caractères.
Sa technologie Shockwave a été une innovation importante pour le World Wide Web, car elle permet de présenter des animations et des séquences vidéo de bonne qualité en les compressant largement et donc en réduisant le temps de chargement. Shockwave est intégré dans le navigateur Web Netscape Navigator 2.0 ; des services en ligne tels que CompuServe lui ont accordé une licence.
Elle a acquis Altys (fabricant de Freehand), Fauve Software (développeur de xRes et Matisse) et OSC (développeur de DECK II).
Freehand Graphics Studio 7.0 est l'un des derniers produits de Macromedia.
Macrocommandes d'un tableur, tel qu'Excel, qui sont enregistrées sous le format du fichier et qui, au moment du démarrage, sont automatiquement intégrées dans l'interface utilisateur d'Excel.
Ce terme technique appartenant au domaine de la conception graphique désigne la sélection et la disposition de polices de caractères en imprimerie (journaux et périodiques, livres, brochures, affiches, pochettes de disque, etc.). Il désigne aussi les décisions relatives à la mise en page d'un document imprimé, c'est-à-dire à l'impression en noir et blanc ou en couleur, des titres, du corps du texte et des images (voir microtypographie).
Dispositif servant à recevoir des supports de données (par exemple des CD-ROM) dans un échangeur de CD.
Le jeu d'action Magic Carpet simule un tapis volant. L'équilibre entre le bien et le mal a basculé dans les mondes de Magic Carpet. L'objectif est de rétablir cet équilibre. Le joueur incarne donc un magicien qui s'oppose à d'autres magiciens sur 50 niveaux de jeu au total (voir niveau) dans un environnement produit par ordinateur.
Le jeu se caractérise par sa multitude d'actions 3D, son graphisme SVGA exceptionnel, ainsi que par ses nombreux niveaux tactiques. L'atmosphère du jeu est digne des Mille et Une Nuits.
Le second épisode, Magic Carpet II, repose sur le même principe que le premier, mais il offre un graphisme de qualité supérieure, des options et des niveaux supplémentaires.
Dans sa version 97, ce programme conçu par la Société Quaterdeck permet une meilleure exploitation de la mémoire vive sous le système d'exploitation Windows 95 et optimise les performances des logiciels.

Magnétoscope
Les magnétoscopes ont été créés pour l'usage personnel et pour l'enseignement. Ils enregistrent les images sur bande magnétique suivant le procédé d'enregistrement hélicoïdal, images qui sont ensuite retransmises sur un poste de télévision. Il existait, au départ, plusieurs systèmes : VIDEO 2000, Betamax et VHS (Video-Home-System). Actuellement, seuls les magnétoscopes VHS sont encore disponibles.
On appelle "mail" les messages (communications, lettres) informatiques, envoyés par modem, ISDN, réseau, etc. (voir e-mail). Il est nécessaire d'avoir un programme spécial pour l'envoi et la réception de ces messages.
Voir :
Les "mailing lists" de l'Internet offrent, dans des forums de discussion, un service semblable aux Newsgroups de Usenet. Ce sont des lettres collectives. Un modérateur les envoie par e-mail à toutes les personnes sur la liste. Il est possible de s'abonner à un thème particulier. Toutes les informations, formulées dans les forums, concernant ce thème sont alors transmises à l'abonné, par l'intermédiaire de sa boîte aux lettres, sans qu'il ait besoin de les chercher. Le contenu est souvent de meilleure qualité dans les forums que dans les newsgroups.
Fonction d'un logiciel de traitement de texte permettant de fusionner un texte type et une liste (ou base de données) d'adresses pour l'envoi en nombre d'un courrier type personnalisé (voir publipostage et mailing list).
On appelle "mailreader" un programme-client permettant de recevoir, de lire ou d'écrire du courrier électronique (voir e-mail).

Serveur qui permet l'échange de courrier électronique (voir e-mail) entre les membres d'un réseau. Il dispose de programmes et des capacités nécessaires (par exemple, des zones mémoire pour le courrier). C'est également lui qui distribue les messages aux personnes auxquelles ils sont adressés.
Voir carte mère.
Voir ordinateur central.
Avec l'accroissement de la complexité des systèmes informatiques, leur maintenance devient primordiale (on en attend une durée de vie proportionnelle à un financement important).
La maintenance implique plusieurs types d'interventions :
lorsque certaines fonctions ne respectent pas leurs spécifications, on parle de maintenance "corrective" ;
lorsque l'intervention anticipe sur les problèmes identifiés, on parle de maintenance "préventive" ;
lorsque l'intervention procède d'un mélange de problèmes identifiés et d'évolutions attendues des matériels/logiciels, on parle de maintenance "évolutive".
Dans la pratique, la maintenance des matériels signifie un simple remplacement, tandis que la maintenance du logiciel implique un contrôle des versions (voir version). Dans le cas des logiciels les plus courants du marché, l'acquisition des nouvelles versions se fait normalement dans des conditions avantageuses.
On appelle "maîtres" les dispositifs (par exemple, un disque dur) ou les ordinateurs pouvant prendre en charge le pilotage d'un autre dispositif ou d'un autre ordinateur.
Dans le cas des disques durs à bus AT (voir IDE, EIDE), un disque est configuré en tant que maître et l'autre, sur le même canal, en tant qu'esclave. Le contrôleur du maître se charge du pilotage et transmet à l'esclave les instructions provenant du bus.
Un ordinateur qui en commande un autre à distance par ligne téléphonique ou directe est également appelé "maître".
Au sein de l'ENST, il a travaillé sur le traitement optique de l'information et de l'holographie numérique. Plus tard, il a étudié, le traitement numérique de l'image et la reconnaissance des formes.
Lettre plus grande que la minuscule, et généralement de forme différente. Elle est également appelée "capitale". Voir traitement de texte.

(En anglais, "joystick") Périphérique d'entrée utilisé pour les jeux (voir jeu vidéo) et connecté au port pour manette de jeux. Il comprend un manche inclinable dans toutes les directions, qui sert à déplacer les personnages d'un jeu à l'écran. Il dispose également de boutons qui commandent des actions particulières, comme sauter ou tirer. La manette de jeu est une version plus simple du joystick.
Chercheur américain d'origine française. Il lance en 1976 la théorie des fractales (voir fractale) qui bouleversa notamment l'interprétation graphique et les système de compression.

Périphérique d'entrée pour ordinateur, semblable, par sa fonction, au manche à balai. Elle est utilisée dans les jeux informatiques (voir jeu vidéo), pour déplacer des objets à l'aide de leviers ou de boutons mobiles. Les fonctions correspondantes, comme par exemple l'accélération d'une voiture de course, sont activées à l'aide d'autres boutons. Certaines manettes permettent à deux personnes de jouer en même temps.
Les manettes de jeu sont indispensables pour manipuler un simulateur de vol. Des modèles comme le F16CombatStick, le FlightStick Pro ou le JetStick incorporent trois à cinq boutons auxquels sont associés des actions différentes, ainsi qu'un "switch hat", une sorte de mini-manette de jeu directionnelle, manipulée à l'aide du pouce et qui permet de "bouger la tête" pour regarder autour de soi dans un cockpit. Certaines manettes de jeu sont également munies d'une molette de réglage des gaz. D'autres, comme le FireBird 2, le WingMan Warrior ou le Predator Extreme offrent la possibilité de programmer les boutons et les molettes, ce qui est très pratique pour des jeux comme Quake ou Duke Nukem 3D.
Il existe également des manettes de jeu particulières, calquées sur les manettes de consoles (voir console de jeux) ou "gamepad", et comportant par exemple les boutons A, B, C (coups portés avec les mains dans les jeux de combat) et X, Y, Z (coups portés avec les pieds).
Voir Day of the Tentacle.
Ce jeu est en fait l'ancêtre de Myst : il affiche des écrans fixes dans lesquels le joueur ramasse des objets ou fait agir les objets de son inventaire avec ceux du décor.
Il s'agit d'une intrigue policière des mieux ficelées. La difficulté réelle du jeu tient dans le questionnaire final qui est assez ardu même pour un joueur expérimenté. Mais c'est aussi ce questionnaire qui fait l'intérêt du jeu.
Le joueur incarne un détective privé, Jérôme Lange, engagé pour résoudre une affaire de meurtres dans le manoir de Morteville. Pour réussir à trouver le meurtrier, le joueur doit résoudre de nombreuses énigmes (voir énigme), découvrir des caches secrètes, fouiner dans les chambres, interroger les personnes présentes. L'ambiance oppressante fait tout à fait penser aux "Dix petits nègres" d'Agatha Christie.
Maupiti Island est la suite du Manoir de Morteville.
Le déroulement du jeu est le même, mais cette fois-ci l'intrigue se déroule sur une île des Caraïbes où plusieurs meurtres ont lieu alors que le joueur, Jérôme Lange, s'y trouve. Le joueur doit mener l'enquête en explorant l'île. Les graphismes de Maupiti Island bénéficient d'un rendu et d'une qualité exceptionnelle. Le scénario est aussi bien ficelé et aussi prenant que dans le premier opus.
Partie d'un nombre à virgule flottante qui contient les chiffres et les signes du nombre représenté (voir virgule flottante).
Guide d'utilisation qui accompagne les composants matériels et logiciels (voir logiciel).
Jim Manzi est l'ancien P.-D. G. de Lotus, qui remplaça Kapor, Mitchell. Il est entré chez Lotus en 1983 en qualité de directeur marketing. Il quitte son poste en octobre 1995, après le rachat de la Société par IBM.
Ce processus consiste à attribuer un nom d'unité à un répertoire de réseau sous Novell Netware. Le mappage est nécessaire pour qu'un autre ordinateur puisse accéder au répertoire.
Logiciel de calcul symbolique (voir tableur) destiné aux professeurs et aux étudiants scientifiques, qui s'inspire des travaux de Stephen Wolfram.
D'autres logiciels existent sur le marché avec plus ou moins les mêmes ambitions : Mathematica, Mathcad, etc.
Physicien italien (1874-1937). C'est en 1895, à travers différentes expériences, qu'il va prouver la possibilité d'utiliser les ondes radios afin de transmettre des messages sur de longues distances. Il recevra le prix nobel en 1909. Son invention ouvre l'ère de la télécommunication.
Héros du jeu du même nom lancé par Nintendo. Il apparaît pour la première fois en 1980 ; il était charpentier et escaladait des échafaudages en évitant les tonneaux lancés par le gorille Donkey Kong. En 1984, il réapparaît comme plombier dans son propre jeu et connaît un gigantesque succès.
Machine à calculer électromagnétique, appelée également "Harward Mark I" ou "Automatic-Sequence Controlled Calculator". Howard Aiken conçut les plans de cette machine dès la fin des années 1930 à l'université d'Harvard. C'est la Société IBM, dirigée alors par Thomas Watson, qui se chargea de sa construction. Les entrées/sorties s'effectuaient par carte perforée et le pilotage par bande perforée. La Mark II fut élaborée par les anglais en 1943 pour contrer ENIGMA.
Également appelée repère. Une marque permet d'aller directement à l'endroit indiqué dans un texte ou dans un programme. Il peut s'agir d'une marque de texte, utilisée dans les gros documents. En programmation, les marques sont généralement utilisées comme cibles pour les instructions de saut.
Dans un logiciel d'application, un masque est un domaine prédéfini dans lequel l'utilisateur entre des données. Les champs de saisie et les champs descriptifs sont souvent différenciés par des couleurs. Sous Windows (généralités), une fenêtre de dialogue est un masque de saisie ou un masque écran.
Voir formulaire.
Voir aussi :
Un des trois modes de représentation des tables. Le masque de saisie comporte uniquement un enregistrement de données dont les champs (voir champ de données) sont placés les uns à la suite des autres.
Voir également formulaire.
Avec l'indicateur d'interruption IF dans le registre de processeur (E)FLAGS des processeurs 80x86, la prise en charge d'une demande d'interruption peut être enclenchée ou masquée, par des composants matériels périphériques. Si l'UCT est accaparée par une tâche importante qui ne doit pas être interrompue, le traitement des interruptions matérielles (voir interruption) en est empêché. Si la phase critique du programme est déjà passée, ce traitement est de nouveau autorisé.
Cependant, le contrôleur d'interruption, qui prend acte des interruptions matérielles et les achemine en fonction de leurs priorités respectives (voir niveau d'interruption) jusqu'à l'UCT, est lui aussi programmable au plus bas niveau par une prédéfinition des masques d'interruption (voir masque).
Elément important des écrans couleur (voir moniteur) à tube cathodique. Trois points lumineux, figurant les trois couleurs fondamentales (voir RVB), sont projetés sur la face interne de l'écran pour chaque point d'image. Le masque perforé se trouve juste devant. Il comporte à son tour trois minuscule trous pour chaque point d'image. Les trois faisceaux d'électrons séparés, attribués chacun à une couleur fondamentale, ne peuvent atteindre que les points lumineux qui leur correspondent, ce qui permet de produire une image aux couleurs réalistes grâce à l'intensité des faisceaux d'électrons.
Sur les écrans modernes, le masque perforé est de plus en plus souvent remplacé par un masque à fente (fait de fils métalliques finement tendus) qui remplit la même fonction.
On le nomme "hardware" en anglais. C'est l'ensemble de tous les composants physiques d'un système informatique. Il s'oppose au logiciel, ou ensemble des programmes indispensables au fonctionnement du matériel (voir aussi firmware).
On appelle "matériel mixte" l'assemblage de composants matériels (voir aussi matériel informatique) de différents fabricants pour former un système informatique.
Ce logiciel spécialisé dans la représentation en images de fonctions mathématiques bi- et tridimensionnelles a été créé par la Société Wolfram Research. La 1re version est apparue le 23 juin 1988. Mathematica 3.0 est la nouvelle version de référence.
Logiciel de calcul scientifique similaire à Mathematica et édité par Mathworks. Matlab permet de créer un véritable environnement scientifique adapté au calcul numérique et à la visualisation des simulations.
Les ombrages, les textures (voir texture), les surfaces complexes non euclidiennes, les courbes de niveau et l'analyse des signaux sonores complètent une palette déjà riche en outils.
Matra était à la base un spécialiste de l'électronique d'armement et de missiles. Au début des années 1970, la Société se diversifia dans l'automobile. Dans les années 1980, Matra décide d'investir dans l'informatique grand public. Il passe un accord avec Tandy pour fabriquer sous licence son ordinateur qu'il baptise "Alice".
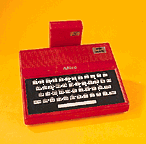
Le modèle "Alice" par Matra
L'État ayant choisi pour l'approvisionnement du marché de l'Éducation nationale Thomson au détriment de Matra, "Alice" ne survivra pas. Matra tente alors d'introduire une machine de bureau, puis se recentre sur les mini-ordinateurs.
Matra abandonnera définitivement l'informatique en vendant cette dernière activité à Philips.
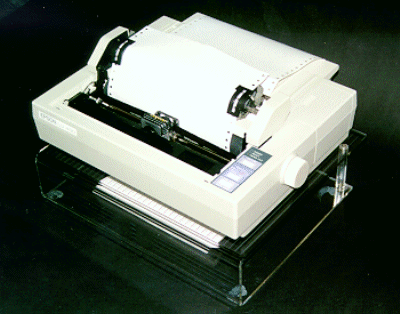
Ce mot désigne le modèle de saisie ou de sortie d'objets sous forme de points, transmis par un scanner, une imprimante ou un écran. Les objets se composent d'une matrice de points à deux dimensions.
On parle souvent aussi d'une matrice de points. Une imprimante matricielle, par exemple, représente le texte et les graphes par des points organisés en lignes et en colonnes (voir imprimante, imprimante à jet d'encre).
On appelle ainsi un message personnel envoyé à un autre utilisateur du réseau Fido.
En 1918, création de la Matsushita Electric Housewares Manufacturing Works, qui se spécialise dans la production de connecteurs. En 1952, la Société commercialise des téléviseurs noir et blanc (télévision), puis en 1958, des magnétophones. En 1963, elle se lance dans la production du micro-onde. En 1989, le fondateur de cette Société, Konosuke Matsushita, meurt à l'âge de 94 ans. En 1990, Matsushita rachète la MCA. Depuis 1993, son nouveau président est Yoichi Morishita.
La structure logique et électrique en forme d'anneau d'un réseau Token Ring est physiquement exécutée en étoile à l'aide d'un répartiteur central appelé MAU, ou encore MSAU (pour MultiStation Access Unit). Comme pour les manchons, il existe des MAU actifs et passifs, selon qu'ils amplifient ou non le signal. La connexion des postes de travail s'effectue par deux lignes doubles réunies dans une gaine (voir câble). Une paire de câbles sert à la réception des données, l'autre à l'envoi. Si aucun ordinateur n'est relié ou si le câble est défectueux, l'anneau est refermé par le MAU. Il est possible de raccorder d'autres MAU à un MAU à l'aide d'interfaces ; dans cette configuration, il faut toujours fermer un anneau actif et un anneau supplémentaire de sécurité avec un câble double. Le MAU est ainsi capable de corriger des erreurs dues à des ruptures du câble en excluant (si possible) les endroits défectueux et en refermant l'anneau par le câble de sécurité.
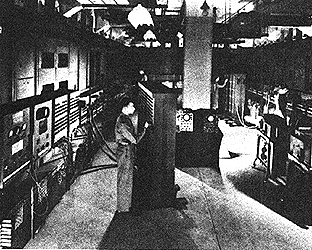
ENIAC (1945)
Ingénieur américain (1907-1980). Concepteur avec John P. Eckert du premier ordinateur américain, l'ENIAC ("Electronic Numerical Integrator and Computer").
En 1942, devant l'avancée des troupes allemandes, les alliés décident de lancer le projet PX qui consiste à élaborer une énorme calculatrice. Basée à l'Université de Pensylvanie (Moore School), l'équipe va utiliser la technologie des tubes sous vide (17 468 tubes exactement), dont l'oscillation provoque un signal exploitable. Le transistor n'avait en effet pas encore été inventé.
Avec l'aide de Betty Jennings et Frances Bilas, les premiers programmeurs, qui étaient des femmes, l'ENIAC pouvait implémenter 5000 additions et 300 multiplications en une seconde (contre 100 millions aujourd'hui), ce qui était à l'époque déjà 1000 fois plus rapide que les machines à calculer classiques (voir machine à calculer).
Le but secret de l'Eniac fut bien entendu l'élaboration de la bombe atomique.
Le public américain ne fut mis au courant de cette invention que le 14 février 1946.
En 1944, l'équipe de développement de l'Eniac proposa de créer le concept de "programme stocké". C'est John von Neumann qui, délaissant le laboratoire de Los Alamos, rejoignit Princeton pour concevoir l'EDVAC et réussit le premier à appliquer ce concept.
En février 1950, la Société Eckert-Mauchly Computer Association propose de commercialiser un ordinateur pour un million de dollars, l'UNIVAC et de vendre ainsi leurs capitaux à Remington Rand.
Voir Manoir de Morteville (le).
Voir Mo.
(Abréviation de "money back guarantee") Garantie de remboursement en cas de non-satisfaction, terme utilisé souvent dans le jargon informatique.
(Symbole de Megabit) C'est l'unité de mesure de la quantité d'informations et de la capacité de mémoire.
1 Mbit = 1 024 Kbit = 1 048 576 bits.
(Symbole de "Megabit per Second") C'est l'unité de mesure de la transmission de données.
1 Mbps = 1 048 576 bps.
L'abréviation MCA désigne l'architecture de bus à microcanaux (voir microchannel) introduite par IBM avec l'IBM-PS/2. Incompatible avec le bus ISA, il présente de nombreuses améliorations : toutefois, IBM réclamant une licence aux constructeurs désireux de l'utiliser, ces derniers se sont regroupés en un consortium et ont permis la création de la norme concurrente EISA.
Fabricant à succès de logiciels d'antivirus. Le programme antivirus MacAfee est très connu des utilisateurs de PC, en partie grâce à sa commercialisation sous forme de shareware, permettant de tester avant d'acheter. Vous pouvez obtenir la dernière version à l'adresse Internet http://www.macafee.com, auprès de nombreux services en ligne ou bien sur des CD de compilation de shareware.
Voir microchannel, bus.
(Abréviation de "multicolour graphic array") Standard graphique obsolète, qui fonctionnait avec une résolution de 640 x 480 points d'image pour 16 couleurs ou avec 320 x 200 points d'image et 256 couleurs. Les cartes graphiques modernes atteignent des résolutions beaucoup plus élevées, mais le mode MCGA a quand même survécu jusqu'à nos jours comme mode d'exploitation possible d'une carte graphique.
Ce groupe possède des compétences dans de nombreux secteurs d'activité. On le trouve notamment présent dans le domaine informatique grâce à des revues comme BYTE.
(Sigle de "Microwave Communications Incorporated") Cette Société de télécommunication est née en 1963, sous l'impulsion de John D. Goeken et de ses associés, aux États-Unis. Son objectif était de construire un réseau de télécommunication, entre Chicago et Saint Louis, basé sur l'utilisation de répéteurs d'ondes ultracourtes.
En 1968, le FCC autorise MCI a utiliser le réseau de télécommunication de AT and T.
Cette année là, Goeken et William McGowan décide de réitérer leur expérience, mais cette fois-ci sur l'ensemble des États-Unis. C'est alors la création de MICOM (Microwave Communications of America Inc.), puis de MCI Communications Corporation.
Les profits engrangés par la Société lui permettent d'étendre son action au-delà des États-Unis. En 1983, MCI International offre alors des communications longue distance vers le Canada, puis l'Europe, en 1984.
Aujourd'hui, MCI utilise les technologies de pointe et les méthodes commerciales les plus innovantes afin de faire bénéficier à ses utilisateurs des coûts les plus bas tout en préservant et en améliorant la qualité du service.
D'autre part, depuis le 3 novembre 1996, MCI a fusionné avec le géant britannique des télécommunications, British Telecom, sous le nom de Concert.
(Abréviation de "Media control Interface") Nom d'une interface logicielle adaptée à tous les systèmes et indépendante des fabricants (voir logiciel, interface, API). Celle-ci fut élaborée conjointement par les firmes Microsoft et IBM pour devenir une norme de l'exploitation des composants matériels multimédias, comme les cartes son (voir carte son), les lecteurs de CD-ROM et les cartes de gestion de recouvrement.
Voir aussi MCI (Société).
Sociologue canadien (1911-1980). Il laisse derrière lui une œuvre immense qui éclaire notre époque d'une intelligence prospective et visionnaire. Les notions de "village global", de "média", d'"innovation technique comme prolongement de notre intellect" marquent à jamais la pensée contemporaine de chercheurs comme Negroponte ou Derreck de Kerkove.
Bibliographie
1962 : La Galaxie Gutenberg
1964 : Comprendre les média
1. Abréviation de MiniDisc, support de données réinscriptible de 2,5 pouces, développé par Sony pour l'enregistrement audio dans le domaine de la hi-fi. Voir MiniDisc pour plus d'informations.
2. Abréviation de Make Directory (créer répertoire) : commande interne du DOS (voir COMMAND.COM) permettant de créer un nouveau répertoire. Par exemple, la commande "md texte" crée, dans le répertoire choisi, le sous-répertoire "texte".
(Abréviation de "monochrome display adapter") Ancien standard graphique pour PC, uniquement destiné à l'affichage de textes, qui fonctionnait avec 25 lignes de 80 caractères chacune.
On désigne ainsi une nouvelle technique de fabrication des composants DRAM destinés à la mémoire de travail d'un PC ou à la mémoire graphique d'une carte graphique.
Cette technique ouvre de nouvelles possibilités. Elle consiste à diviser la mémoire en bancs de 32 Ko chacun, à les tester individuellement et, s'ils sont bons, à les gérer ensemble.
La technique MDRAM offre donc plusieurs avantages : une meilleure exploitation, la possibilité de diviser la mémoire en bancs de taille adaptée, ainsi qu'une plus grande rapidité du transfert de données, et ce, grâce à une technique d'entrelacement.
Voir MTBF.
Ensemble d'outils destinés à la conception par ordinateur (voir CAO), qui permet principalement de créer des objets en trois dimensions (voir 3D).
Ensemble d'outils d'intégration multimédia d'Apple (le résultat est également accessible sur PC).
Le concept HyperCard d'Apple a inspiré d'autres éditeurs, y compris ceux qui visent le monde PC.
Voir support de données.
Voir Mbit.
Voir MB.
Voir Sega.

Ce logiciel édité par Micro Application est dédié aux enfants âgés de 3 à 13 ans. D'une grande facilité d'utilisation, il constitue un véritable studio d'impression que les parents et les aînés adopteront pour animer les fêtes des enfants. Ce CD-ROM est doté d'une interface simplifiée contenant un menu déroulant qui propose plus de 150 activités diverses que l'on peut imprimer. Fruit du travail de conseillers pédagogiques et de parents, ce logiciel contient des puzzles, des dominos, des jeux éducatifs (calcul, alphabet, code de la route, etc.), des jeux de rôle, un jeux de l'oie, une bataille navale, des objets à imprimer, à découper et à bricoler (masques, chapeaux, poupées, etc.), des cartes d'anniversaires, des invitations, du papier à lettre, des coloriages, des posters, des chansons, des poèmes, etc.
Jeu de course automobile virtuelle. Les animations et les graphismes 3D sont excellents : vous pouvez choisir entre cinq paysages futuristes différents. Cinq équipes adverses, toutes menées par des chefs plus astucieux les uns que les autres, tenteront de vous faire échouer.
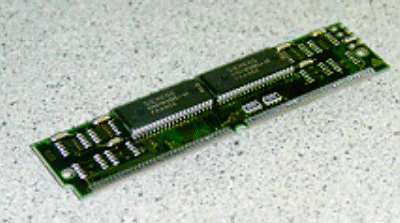
RAM-EDO
Terme générique qui désigne tous les types de composants et supports pouvant stocker des données pour l'ordinateur.
On distingue les mémoires permanentes des mémoires volatiles.
Dans les mémoires permanentes, les données sont conservées sans alimentation en courant (voir les supports de données disque dur, disquette, lecteur de CD-ROM ou bien la mémoire à semi-conducteur ROM, PROM, EPROM et EEPROM).
La mémoire volatile est représentée par la RAM ; lorsque l'utilisateur éteint l'ordinateur, elle perd automatiquement toutes les données.
Les fichiers de programmes à exécuter, sont chargés par un support de données permanent dans la mémoire de travail volatile, où sont traitées les instructions du processeur. Les résultats sont généralement déposés sous forme de fichiers sur des supports de données, ou bien transmis à d'autres périphériques (l'imprimante par exemple).
Voir aussi :
Support de mémoire non volatil dans lequel les données sont stockées sous forme de bulles microscopiques (de 1 à 3 microns environ), qui sont appelées "domaines" et sont sensibles aux champs magnétiques. La base de cette mémoire est un film très fin de substances magnétiques. En raison de sa fabrication complexe et coûteuse, cette technique, développée dès les années 1960, n'a pas pu s'imposer malgré une densité d'enregistrement très élevée pour une vitesse d'accès remarquable.

Terme générique désignant une mémoire de masse qui stocke des données sur un ou plusieurs disques magnétisés en rotation. Le disque dur ou la disquette sont des exemples de mémoires(voir mémoire) à disque magnétique.
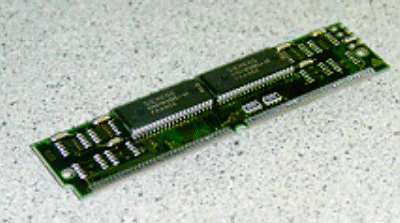
RAM-EDO
Les caractéristiques principales en sont un temps d'accès réduit et une miniaturisation incessante qui permet de baisser les coûts par unité de mémoire et d'augmenter la capacité de mémoire disponible dans les systèmes.
On distingue parmi les circuits de mémoire :
les mémoires mortes, ou ROM ("read only memory") et les mémoires de lecture/écriture ;
les éléments RAM ("Random Access Memory", mémoire à accès direct).
Ces derniers tirent leur nom de l'affectation aléatoire d'une zone mémoire.
Pour ce qui est de la RAM, on peut procéder à une seconde distinction entre les RAM statiques (voir SRAM), qui conservent les informations même sans rafraîchissement régulier, et les RAM dynamiques (voir DRAM), sur lesquelles les informations doivent être rafraîchies cycliquement.
Voir également rafraîchissement, cycle de rafraîchissement, ROM, RAM, PROM, EPROM.
Mémoire élaborée pour stocker des données. Les ferrites sont des composés chimiques de fer possédant une résistance électrique élevée et de bonnes qualités semi-conductrices.
(ou mémoire à tores de ferrite) Type de mémoire à l'origine de la mémoire de travail des calculateurs jusqu'aux années 1970, avant que la RAM et la mémoire à semi-conducteur ne fassent leur apparition.
La biologie moderne explique les différences entre les individus par le codage chimique, qui détermine chaque branche des êtres vivants : on parle d'un code génétique. Les industriels, en particulier IBM, essayent depuis longtemps d'utiliser ce véhicule comme mémoire informatique. Comme d'autres idées nouvelles (tel l'ordinateur quantique), la faisabilité pratique reste encore à démontrer.
Antémémoire de processeur intégrée à un processeur et qui permet d'accélérer le travail de l'UCT.
Depuis l'apparition du 486, ce type d'antémémoire est intégré aux processeurs de la firme Intel (voir i80x86).
Outre cette mémoire cache de premier niveau, une autre antémémoire, appelée mémoire cache de second niveau, est généralement installée sur la carte mère, à l'extérieur du processeur.
Voir antémémoire par rafales.
On appelle "mémoire conventionnelle" ou "mémoire de base", la zone de mémoire située en deçà des 640 Ko. La division en mémoire conventionnelle et autres zones de mémoire est très importante pour le MS-DOS.
Comme la vitesse de propagation des signaux est essentielle pour augmenter les performances d'un matériel informatique, dans les matériels destinés aux futurs ordinateurs, on diminue la température pour atteindre un niveau de supraconductivité (voir mémoire).

Notion regroupant les éléments de mémoire et les supports de mémoire (voir support de mémoire) à haute capacité de mémoire sur lesquels sont conservées les données en l'absence d'alimentation secteur. En font partie, entre autres éléments, le disque dur, la disquette, le CD-ROM, le disque MO ou la bande magnétique.
Mémoire rapide de l'ordinateur, à laquelle on peut avoir accès pour lire ou écrire (voir RAM) et où sont stockés les composants actifs du système d'exploitation, les parties de programmes d'application dont l'utilisation est imminente, ainsi que des données.
Lorsque les ordinateurs utilisent des systèmes d'exploitation graphiques comme Windows ou OS/2, la taille de la mémoire de travail est déterminante pour la vitesse de travail du système et des différents programmes. Les ordinateurs dotés d'un processeur rapide et d'une mémoire de travail relativement réduite sont souvent plus lents que les ordinateurs à grosse mémoire de travail et à processeur légèrement plus lent.
(En anglais, "extended memory") C'est une zone de mémoire située au-delà du Mo, que l'on peut atteindre sous MS-DOS.
On ne peut utiliser complètement (en mode protégé) cette zone de mémoire qu'avec un PC doté d'un processeur 286 ou plus récent.
Sous DOS, cette zone ne peut être exploitée qu'à l'aide de pilotes spéciaux (par exemple avec HIMEM.SYS) pour le stockage de données, le protocole XMS (Extended-Memory Specification) défini par Lotus, Intel et Microsoft, qui fournit quant à lui une norme correspondante (voir aussi EMS).
Voir EMS.
Voir mémoire.
On appelle généralement "mémoire étendue", la zone de mémoire située au-delà de 1 Mo adressable sous MS-DOS et pouvant être installée sur des PC équipés du processeur 286 ou plus récents.
Sous DOS, on ne peut atteindre cette zone qu'à l'aide de gestionnaires spéciaux. Le protocole XMS, défini par Lotus, Intel et Microsoft, qui fournit une norme correspondante (voir aussi XMS).
Zone de mémoire qui n'est pas intégrée à l'unité centrale d'un PC. Elle se présente sous la forme d'un dispositif séparé connecté par un câble à une interface appropriée. Les mémoires externes sont, par exemple, des lecteurs externes de disquettes, de disques durs ou de CD-ROM, des unités de RAM, etc. On utilise couramment des interfaces adaptées au système propriétaire, l'interface parallèle du PC, ou de plus en plus souvent le bus SCSI.
La mémoire flash est le nom d'un type de ROM élaboré par Intel, pouvant être écrit ou effacé à l'aide d'un processus électronique (voir aussi EEPROM).
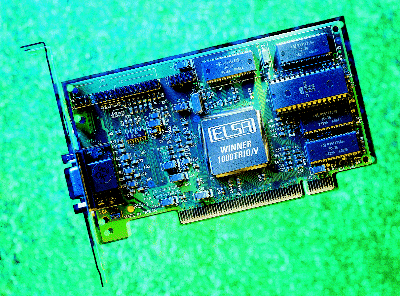
La résolution et le nombre des couleurs d'une carte graphique dépendent de la taille de sa mémoire graphique : plus les couleurs sont nombreuses et la résolution haute, plus la mémoire doit être grande. Lorsque l'on choisit de travailler en haute résolution, les couleurs disponibles sont moins nombreuses et, réciproquement, un plus grand nombre de couleurs entraîne des résolutions plus faibles.
On trouve d'habitude sur les cartes graphiques des composants spéciaux RAM, DRAM ou VRAM et, depuis quelque temps, WRAM, également. Les composants mémoire VRAM permettent simultanément l'écriture et la lecture, de sorte que la représentation sur écran s'effectue plus vite. Cependant, ces puces mémoire sont sensiblement plus chères.
Parfois, la mémoire haute est également appelée "mémoire réservée", "mémoire supérieure", ou encore "adaptateur de segment". C'est l'espace de mémoire haute situé au-delà de la mémoire conventionnelle, réservée, lors de la conception du PC IBM, à la mémoire d'écran, au BIOS et aux extensions matérielles.
La monopolisation du haut de la mémoire par la RAM ou la ROM n'est pas permanente habituellement. Selon les PC et l'équipement matériel, certains blocs sont chargés ou, au contraire, laissés libres. Ces blocs sont appelés UMB (Upper Memory Blocks).
Les UMB non utilisés peuvent l'être par le système d'exploitation, grâce à un matériel spécial (voir NEAT), un gestionnaire de mémoire des processeurs modernes ou par des pilotes spéciaux, par exemple EMM386.EXE, livré avec MS-DOS et Windows (voirWindows (généralités)).
Des gestionnaires de périphériques ou des programmes résidents chargés dans l'UMB libèrent de la place dans la mémoire conventionnelle pour des programmes d'application.
(En anglais, "lower memory") Partie inférieure de la mémoire conventionnelle d'un PC compatible IBM, dans laquelle sont chargés, sous MS-DOS, de nombreuses données du système et le système d'exploitation, avec tous ses gestionnaires.
Les versions DOS actuelles permettent de transférer certaines parties du système d'exploitation dans d'autres zones de mémoire, afin de libérer la mémoire conventionnelle pour des programmes d'application.

Terme générique désignant les mémoires de masse (voir mémoire de masse) qui stockent des données sur des supports de données (voir support de données) magnétisés. Font partie des mémoires magnétiques : le disque dur, la disquette, la bande magnétique et la carte magnétique.
Voir ROM.
Mémoire morte effaçable : voir EPROM.
Mémoire morte programmable : voir PROM.
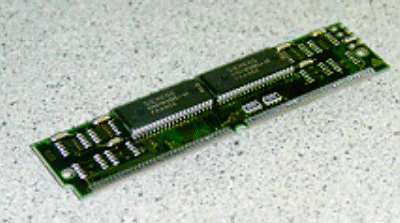
La mémoire principale comprend toute la mémoire à laquelle peut directement accéder le processeur. En font partie : la mémoire de travail (voir aussi RAM) et quelques mémoires mortes (voir ROM) qui contiennent des programmes et des données pour les tâches internes (voir BIOS).
La mémoire de masse (voir disque dur par exemple) ou la mémoire située sur la carte graphique ne font pas partie de la mémoire principale.
Voir SRAM.
Zone de la mémoire tampon dans laquelle les données sont disposées selon le principe FIFO ("First In First Out", premier entré, premier sorti).
Les informations ou les paramètres écrits en premier sont traités en priorité. Cette zone est gérée comme une pile.
(Abréviation de "Last In First Out", dernier entré, premier sorti) Mémoire tampon où les dernières données qui ont été écrites sont traitées en premier. Une pile de sauvegarde fonctionne selon ce principe (voir mémoire tampon FIFO).
(En anglais, "buffer") La mémoire tampon est un secteur de la mémoire destiné à stocker temporairement les données lors de la lecture et de l'écriture (voir cache). Il est possible d'indiquer dans CONFIG.SYS combien de secteurs tampons, de 512 octets chacun, doivent être réservés au système d'exploitation MS-DOS pour la lecture et le stockage de données.
On utilise souvent une mémoire tampon et une régulation de transmission appropriée pour transmettre des données entre deux éléments (ou systèmes) qui n'ont pas le même taux de transfert. Ce sont très souvent les récepteurs qui sont plus lents que les émetteurs. La mémoire tampon stocke alors des données jusqu'à ce qu'elle soit pleine ou qu'elle soit remplie à un niveau prédéterminé. Le récepteur doit alors envoyer un signal à l'émetteur pour qu'il interrompe la transmission. Lorsque le récepteur a fini d'exploiter les données reçues (ou en a exploité un pourcentage déterminé), il envoie un nouveau signal pour que l'émetteur reprenne la transmission. Dans le cas où le récepteur est plus rapide (ou de vitesse équivalente) aucun problème ne survient. Il se peut aussi que l'émetteur gère sa mémoire tampon pour s'adapter au récepteur. Dans ce cas, il peut utiliser sa mémoire tampon pour y stocker brièvement les données avant de les envoyer suivant un rythme déterminé par son contrôleur. Dans les deux cas, les deux partis sont gagnants.
Elle est caractéristique des systèmes d'exploitation (voir système d'exploitation) récents dans le domaine des PC, mais elle existait depuis longtemps dans celui des ordinateurs centraux et de la mini-informatique.
L'idée fondamentale est d'augmenter virtuellement l'espace mémoire en déchargeant dans une zone tampon les codes de programmes et les fragments de données qui ne sont pas constamment nécessaires.
S'il n'y a pas assez de mémoire disponible, le système essaye d'en créer en transférant dans un fichier les données qui n'ont pas été utilisées depuis très longtemps (swap out). Ce fichier est appelé "zone tampon disque" ou "swap file".
Ces données sont à nouveau transférées dans la mémoire de travail lorsqu'on en a besoin (swap in). De cette manière, les applications peuvent utiliser plus de mémoire qu'il n'y en a en réalité. À partir de la série 386, les PC supportent la mémoire virtuelle, ce qui explique son extension actuelle.
Voir RAM.
Voir :
Voir gestion de mémoire.
Voir MMU.
Ensemble de commandes ou d'options présentées sous la forme d'une liste.
Les menus sont généralement intégrés dans une barre de menu, où ils sont classés par thème. La liste des commandes d'un menu est ouverte en cliquant sur le nom du menu avec une souris ou par l'intermédiaire d'un raccourci clavier.
La forme de menu la plus souvent utilisée est le menu déroulant, où les commandes, présentées les unes au-dessous des autres, sont sélectionnées avec la souris ou au moyen d'un raccourci clavier.
Dans les logiciels d'application les plus récents, il existe également des menus contextuels qui sont activés en cliquant sur un objet avec le bouton droit de la souris.
La commande de logiciels à partir de menus s'est principalement développée avec l'introduction de Windows (voir Windows (généralités)).
Voir aussi :
Ce menu est un composant essentiel de Windows 95. Il se trouve dans le coin inférieur gauche de la barre des tâches, sur le bureau de Windows 95. Comme son nom l'indique, il permet de démarrer, avec la souris, les programmes et les fonctions installés sur l'ordinateur. Il est également possible d'y accéder par le clavier, soit avec la combinaison de touches [Ctrl]+[Échap], soit en appuyant sur l'une des deux touches Démarrer présentes sur les claviers Windows 95. Par défaut, le menu Démarrer offre l'accès au Panneau de configuration, aux imprimantes, à la commande Exécuter (pour lancer un programme en tapant son nom de fichier), à une fonction de recherche, à l'aide en ligne, à la liste des derniers documents modifiés et au dossier Programmes, dont les raccourcis (voir raccourci) permettent le lancement de programmes. Il est tout à fait possible d'ajouter à ce menu ses propres fichiers et raccourcis.

Le menu Démarrer de Windows 95
C'est une forme standard de présentation de menu : une fois qu'un concept principal a été choisi dans la liste, une liste de sous-commandes est visualisée. C'est l'une des caractéristiques importantes des interfaces-utilisateur graphiques (voir GUI), mais il existait déjà dans certains programmes DOS.
Utilisé comme menu contextuel, il est affiché à un endroit quelconque de l'écran et peut être déplacé. Il permet de sélectionner des commandes ou des options. Sous Windows (voir Windows (généralités)), il est généralement obtenu en cliquant sur le bouton droit de la souris.
Le menu principal est le menu qui présente les principales fonctions d'un logiciel. Il apparaît après le lancement d'un logiciel et permet à l'utilisateur d'accéder aux sous-menus.
Abréviation de "merci", dans le jargon informatique.
Meridian 59 est le premier MUD graphique de l'histoire de l'Internet. Il s'agit en fait d'un jeu type Doom où le joueur incarne un sorcier qui doit combattre des monstres, des hommes, et d'autres sorciers. La principale différence avec les jeux du type Doom est qu'il se joue exclusivement sur l'Internet contre d'autres joueurs, qui peuvent être... à l'autre bout du monde.
Méthode mise au point durant les années 1978 et 1979, et qui permet la conception et le développement de systèmes d'information. Cette méthode, employée pour une base de données relationnelle, permet de limiter les informations redondantes.
Le mesh ("maille") est un caractère spécial.
Voir mail.
On appelle ainsi les informations sur le statut du système que le matériel informatique, le système d'exploitation ou un programme d'application donnent à l'utilisateur. Un message est par exemple envoyé quand un incident de fonctionnement se produit. Il indique à l'utilisateur les risques possibles et lui suggère comment corriger l'erreur.
Voir aussi mail.
C'est l'ensemble de tous les messages contenus dans un serveur télématique.
Données qui en décrivent d'autres.
Lieu de création, ateliers d'artistes et d'ingénieurs situés à Aubervilliers (93). Fondé par Jack Ralite en 1995, il se veut le point de rencontre entre industriels, artistes (Piotr Kowalski, Ernest Pignon Ernest, Mélik Ouzani, Fred Forest...) et utilisateurs des nouveaux médias, selon le modèle allemand du Bauhaus.
E-mail : metafor@calvanet.calvacom.fr
Voir aussi : art (ordinateur).
Langage permettant de décrire d'autres langages (en particulier des langages de programmation).
Comme exemple, on peut citer la forme normale de Backus, qui est constituée de caractères et de symboles spéciaux, et qui permet de décrire avec précision la syntaxe d'un langage de programmation donné.
Son aventure commence au sein de XeroxPARC, où il va jeter les bases de l'Ethernet. En 1979, il créé la Société 3Com, spécialisée dans les réseaux (voir réseau). En 1990, il devient l'éditeur de InfoWorld, poste qu'il occupera pendant 2 ans et demi.
La météorologie a été l'un des grands secteurs bénéficiaires du développement de l'informatique.
La qualité des résultats dépend des données en entrée et des performances de calcul disponibles. La caractéristique de ces calculs est que beaucoup d'opérations simples doivent être exécutées (quasi) simultanément. C'est pourquoi la météorologie est un utilisateur important du calcul parallèle.
Le calcul à long terme pose des problèmes d'une autre nature. En effet, l'issue d'une situation atmosphérique connue est modélisée par un système d'équations différentielles. Or, ce type de système a montré que le calcul était intrinsèquement instable (pour des raisons mathématiques) : on parle d'"effet papillon" (un battement d'ailes suffit à modifier à moyen terme le comportement d'un système sensible aux conditions initiales). Une nouvelle branche est ouverte dans les mathématiques, celle des "attracteurs étranges" : les nouvelles valeurs sont circonscrites dans un domaine tout en restant individuellement imprévisibles.
La prévision a long terme demeure aléatoire malgré des progrès manifestes.
(Du grec "meta" et "hodos", par la voie) Nom générique, et vulgarisé en particulier par Descartes, d'un ensemble de règles, obligatoires ou non, qui permettent d'atteindre un but.
Le génie logiciel préconise des méthodes spécifiques destinées aux différentes phases du cycle de vie du logiciel : spécification, conception, codage, etc.
Voir méthode à objets.
Il existe, à partir de la méthode de Booch, toute une famille de méthodes qui essayent d'incorporer des "objets" : il s'agit généralement de prendre en charge des entités dont les structures sont stables (structure des données) et qui, de ce fait, sont adressées par des opérations de lecture/écriture également stables.
Film muet, en noir et blanc de Fritz Lang, réalisé en 1926. Outre les nombreuses représentations de machines, l'une des scènes les plus fameuses consiste en la création d'une femme artificielle, un robot, qui est sensée orienter les masses ouvrières et les calmer. À l'époque, les machines, pensait-on, visaient à déposséder l'homme de sa liberté. Ce film illustre bien les angoisses de toute une génération.
Voir automate, golem, vie artificielle, science-fiction.
(Abréviation de "million floating-point operations per second") Unité de mesure qui indique la performance d'un ordinateur, en ce qui concerne les opérations à virgule flottante (voir GFlops).
(Abréviation de "modified frequency modulation", modulation de fréquence modifiée) L'un des plus anciens procédés d'enregistrement pour les disques durs, encore utilisé pour les disquettes. Sur les disques durs, le procédé MFM a été supplanté par différentes variantes du procédé RLL.
En jargon informatique, c'est l'abréviation de "my hat's off to you" (je te tire mon chapeau).
(Symbole de Megahertz) Multiple de l'unité de fréquence, le hertz.
1 Mhz = 1 000 000 cycles / s
Ce virus de boot attaque le secteur d'amorçage des disques durs et des disquettes. Il fut programmé pour s'activer le 6 mars, anniversaire de Michel-Ange, et détruire un grand nombre de données. Il existe aujourd'hui de multiples variations de ce virus qui produisent toutes le même effet, mais peuvent s'activer à différentes dates.
Premier micro-ordinateur au monde, créé par André Truong et François Gernelle, en 1973. Sa conception s'articulait autour du microprocesseur 8008, deuxième microprocesseur d'Intel. Le Micral ne parvint jamais à s'imposer. En 1975, c'est un autre micro-ordinateur, l'Altair 8800, qui triompha aux États-Unis.

Philippe Olivier
Éditeur informatique (no 1 en France) de livres et de logiciels. Philippe Olivier, son actuel P.-D. G., démarre en 1981 l'aventure de Micro Application en éditant un master (langage Basic) destiné à l'univers Commodore. Il s'oriente rapidement vers l'univers de l'IBM-PC, et produit des logiciels (voir logiciel). Entre 1984 et 1985, c'est le lancement simultané de l'édition de livres techniques et de logiciels grand public pour Commodore, Amstrad et Atari.
En 1991, Micro Application devient le no 1 français des éditeurs de livres informatiques. En 1995, plus de 2 millions de produits (livres et logiciels) sont vendus et le chiffre d'affaires s'élève à 120 millions de francs.
La politique de Micro Application consiste à mettre la micro-informatique à la portée de tous. Afin d'y parvenir, la Société s'est fixée trois objectifs :
éditer des produits simples, de qualité et innovants, pour un coût modique ;
développer son partenariat européen avec la Société allemande DATA BECKER, leader sur le marché européen de l'édition du livre et du logiciel grand public ;
distribuer ses produits via tous les réseaux de distribution proches du grand public et sur tout le territoire francophone (Suisse, Maroc, Belgique, Canada, etc.).

Installation hi-fi-Micro
Les microchaînes hi-fi représentent une nouvelle génération de chaînes hi-fi, offrant dans un volume très réduit les mêmes possibilités que les appareils de grande taille. Cette réduction a été possible grâce aux progrès de la microélectronique.
Toutefois, les performances de ces systèmes restent limitées.

IBM PS/1 Mod. 242/282
Désigne le type d'architecture du bus MCA (Micro Channel Architecture) conçu par IBM.
Voir micro-instruction.
Société d'édition informatique, créée en 1993, à vocation généraliste. Elle publie des CD-ROM sous quatre collections :
"Microfolie's", spécialisée dans les produits haut de gamme, comme "La Symphonie fantastique" ;
"Bacchus", spécialisée dans l'œnologie et la gastronomie, avec des titres comme "Le Monde du vin", "Bordeaux" ;
"VMS", spécialisée dans les produits de réalité virtuelle (Sail simulator) ;
"Futura", spécialisée dans les produits à petits prix.
Société d'édition de logiciels (voir logiciel) créée en 1982, actuellement l'une des premières au monde dans ce secteur. Draw 5.0 est l'un des derniers logiciels développé par l'entreprise.
Voir informatique.
Instructions élémentaires utilisées pour le traitement interne des instructions par le processeur.
L'origine du micro-ordinateur est incertaine. Si l'on considère qu'un micro-ordinateur est un ordinateur autonome bâti autour d'un microprocesseur, il faut donc attendre l'apparition du premier processeur. L'INTEL 4004 représente la première tentative, mais on s'accorde à considérer que le premier microprocesseur a été le 8008, disponible à partir de 1971. Le premier micro-ordinateur semble donc être le Micral 8008 qui est vendu à partir de 1973. Mais "autonomie" signifie système de programmation et le Micral, délicat à programmer, était plus un appareil de contrôle en temps réel qu'un micro-ordinateur tel qu'on l'imagine aujourd'hui.
L'Altair américain vendu en Kit en 1974 disposait du premier Basic de Microsoft et pourrait donc bien enlever à Micral la paternité. Cependant, la véritable histoire de la micro-informatique commence vraiment en 1977, avec la mise sur le marché presque simultanée de trois ordinateurs "prêts à brancher" qui vont révolutionner l'industrie de la micro-informatique : L'APPLE 2 d'Apple Computer, le PET de Commodore et le TRS-80 de Tandy. Les trois machines étaient très différentes, l'Apple bâti autour du processeur 6502 de MOS Technologie avait un système d'exploitation radicalement différent du PET, pourtant bâti sur le même processeur. Tandy choisit le Z80 de Zilog, il était donc lui aussi totalement incompatible. Ces trois machines se vendirent en grandes quantités et déterminèrent la suite de l'histoire. Rigoureusement incompatibles, ils exaspérèrent les frustrations des différents propriétaires, les uns envieux des logiciels ou des périphériques des autres. Ces frustrations furent certainement à l'origine de la création de standards logiciels d'abord, avec l'arrivée de CP/M de Digital Research, auquel Apple et Tandy se rallièrent partiellement, puis de standards matériels ensuite, avec l'arrivée, plus tardive, d'IBM et de son PC, suivi de tous ses compatibles.
En général, il est possible de connecter un microphone à la carte son. Les sons reçus peuvent alors être stockés ou traités par l'ordinateur.
Voir MPF 2.
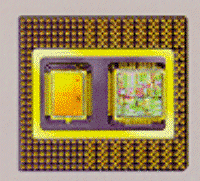
Processeur Pentium Pro
Circuit intégré à une puce (voir CI), qui dispose des fonctions d'un processeur complet. Souvent, cette désignation est limitée (tout comme le concept de processeur) au processeur central ou à l'UCT d'un ordinateur.
Historiquement, le microprocesseur apparaît à la suite de la découverte du transistor.
Actuellement, les microprocesseurs les plus courants pour les PC sont produits par les Sociétés Intel (famille des 80 x 86) et Motorola (famille des 680 x 0). La puce PowerPC, l'alphachip et le tout récent Intel-P6 ou Pentium Pro amorcent de nouvelles orientations.
Le développement technologique des microprocesseurs fut très rapide : en vingt-cinq ans, ils sont passés des 2300 transistors du 4004 aux 5,5 millions du Pentium. La puissance du Pentium Pro est cinq mille fois supérieure à celle de la première puce, mise sur le marché en 1971.
Histoire du microprocesseur
C'est Intel qui, le 15 novembre 1971, lança le premier microprocesseur pour PC. Ted Hoff, le créateur, avait réussi à simplifier le principe du calculateur. La puce de Hoff était en quelque sorte un "processeur universel". Le premier microprocesseur, le 4004, contenait 2300 transistors et exécutait 60 000 opérations à la seconde.
C'est à partir de 1974 qu'Intel voit ses ventes décoller : le 8080 peut exécuter 290 000 opérations par seconde et gère une capacité mémoire de 64 Ko. Le tout est vendu 360 dollars. La Société Digital Equipment Corporation adopte les processeurs Intel.
À partir de ce moment, l'évolution technologique va aller en s'accélérant :
1978 apparition du 8086 (1er processeur 16 bits) ;
Motorola lance le 68000, Intel le 8088 ;
1982 apparition du 80286 (134 000 transistors) ;
1985 apparition du 80386 (1er processeur 32 bits) qui marque le début de Compaq ;
1989 apparition du 80486 (1,2 million de transistors) ;
1994 apparition du Pentium (3,1 millions de transistors) ;
1995 apparition du Pentium Pro (5,5 millions de transistors).
Parallèlement au développement technologique, les coûts ont chuté très rapidement : 1 mips (million d'instructions par seconde) coûtait 225 dollars en 1991, à la fin de 1996, il ne coûtait déjà plus que 7 dollars.
L'évolution continue ; ainsi les processeurs 64 bits devraient-ils apparaître en 1998. Toutefois, le prochain microprocesseur, créé dans la logique du processeur depuis le 386, sera le MMX.
Nom de marque sous lequel la Société Spectrum HoloByte, fondée en 1982, commercialise ses logiciels de jeux et de loisir (voir jeu vidéo). Sous sa forme actuelle, cette Société est le résultat de la fusion, réalisée en décembre 1993, entre Spectrum HoloByte (célèbre pour ses simulations de combat aérien, comme Falcon) et de MicroProse (célèbre pour des logiciels de simulation tels que F-15 Strike Eagle ou Grand Prix). Spectrum HoloByte est également l'éditeur des célèbres Civilization et de RailRoad Tycoon créés par Sid Meier. Elle crée aussi des jeux pour la Playstation de Sony.

Excel 7.0
Microsoft Office est une suite bureautique éditée par Microsoft. La version standard est composée des logiciels Excel, Word pour Windows, du logiciel de présentation assistée par ordinateur Power Point et de Licence Mail (remplacé par l'agenda individuel Schedule+ dans la version pour Windows 95). La nouvelle version, Office 97, a intégré l'Internet et l'intranet.
La version professionnelle comprend, en outre, le gestionnaire de bases de données Access.
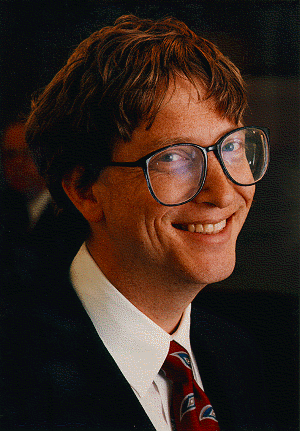
Bill Gates, le fondateur de Microsoft
Histoire
C'est en 1972 que Paul Allen, employé de Honneywell à Boston, et Bill Gates, étudiant à Harvard, créent la Société de développement de logiciels Traf-O-Data. Elle se fixe pour objectif, en 1974, de produire un langage Basic pour l'Altair, l'un des premiers micro-ordinateurs américains. Microsoft est créé en 1975 pour assurer la commercialisation du Basic de l'Altair. Dans les années suivantes, les versions du Basic de Microsoft, adaptées aux différentes générations de microprocesseurs, représenteront le standard et équiperont les premiers ordinateurs grand public tels que Tandy, Apple ou Commodore.
Lorsqu'au début de 1980, IBM finalise son premier micro-ordinateur, il doit naturellement le livrer avec un Basic, puisque c'est la norme de l'époque ; tout aussi naturellement, il pense à Microsoft pour l'écrire. Les premières rencontres entre les deux Sociétés aboutissent rapidement, d'autant que les responsables d'IBM n'apprécient pas la manière désinvolte avec laquelle les traitent les dirigeants de Digital Research pour l'achat de leur système d'exploitation CP/M. Le SPC DOS de Tim Paterson, racheté entre temps par Microsoft, équipera d'abord l'IBM-PC sous le nom de PC-DOS, puis la majorité des micro-ordinateurs. Le succès de l'IBM-PC est immense et entraîne dans son sillage Microsoft, qui a pris la précaution de se réserver le droit de diffuser PC-DOS sous le nom de MS-DOS pour les ordinateurs d'autres marques.
C'est certainement le coté visionnaire de Bill Gates qui a fait le succès de Microsoft. Son implication personnelle dans le développement de Windows, à un moment où la mise en place de l'interface graphique n'était pas une certitude, est à l'origine de l'histoire de ce produit qui, avec la version Windows 95, est le logiciel majeur de la micro-informatique. D'autres produits ont suivi, en particulier Word, le tableur Excel, le système d'exploitation Windows NT, etc., qui ont permis à Microsoft de dominer le marché mondial des logiciels pour PC.
Fondée en 1972 par deux personnes, Microsoft est, 25 ans après, une multinationale de 20 000 personnes, qui règne sans partage sur la quasi totalité des segments logiciels de la micro-informatique ; son président, quant à lui, est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches du monde.
Microsoft s'est également lancé dans la production de matériel informatique, en particulier avec la souris Microsoft et un clavier. Elle a également contribué à l'établissement de normes telles que LIM/EMS et celle pour le PC multimédia. Windows 95 est un système d'exploitation 16/32 bits, destiné a permettre la migration vers des systèmes d'exploitation 100% 32 bits.
L'empire Microsoft, bâti en moins de vingt ans, a réalisé en 1996 un chiffre d'affaires net de près de 45 milliards de francs et connaît toujours une croissance évidente.
Terme technique, à l'instar de macrotypographie, appartenant au domaine de la conception graphique. Une fois la macrotypographie (c'est-à-dire la disposition générale des caractères) terminée, la microtypographie commence. Il s'agit de disposer avec précision les caractères, les interlignes et les intervalles entre les caractères et entre les mots (voir cadratin), mais également d'insérer des lignes vierges ou des trames et de colorer les caractères.
(Abréviation de "Musical Instrument Digital Interface") Interface standard permettant de transmettre des données entre les ordinateurs, les instruments de musique électroniques (synthétiseurs) ou les générateurs de sons. Un ordinateur équipé d'une carte son portant une prise MIDI peut gérer jusqu'à seize instruments de musique selon la norme MIDI (seize canaux).
Les canaux d'entrée/sortie (ou ports) sont de trois types :
MIDI In (entrée) ;
MIDI Out (sortie) ;
MIDI Thru (transmission vers le suivant).
Un synthétiseur, par exemple, reçoit des messages MIDI par son port MIDI In, réexpédie ces messages par son port MIDI Thru et envoie les siens par son port MIDI Out.
La transmission des sons se fait à la vitesse de 31 250 bauds (voir baud). La vitesse de transfert entre instruments est de 32 Kbps. Le format de fichier défini est le SMF.
La norme GENERAL MIDI regroupe l'ensemble des règles qui pilotent les cartes son et les expandeurs compatibles avec la norme.
(Sigle de Marché international de l'édition et des nouveaux média)
Salon créé en 1995 par le groupe Reed. Il regroupe près de 10 000 participants (éditeurs de jeux, de CD-ROM culturels, etc.) et a lieu à Cannes.
Chaque année est remis à cette occasion le Milia d'or.
Ces deux frères sont à l'origine du célèbre jeu Myst.
Une milliseconde équivaut à un millième de seconde. Le temps d'accès à un disque dur est mesuré en millisecondes.
(Abréviation de "multipurpose internet mail extensions") La norme MIME est relativement récente. Elle permet d'inclure directement n'importe quel fichier binaire qui se trouve dans la messagerie e-mail de l'Internet. Il est donc facile d'envoyer des fichiers, et, s'il a le mailreader qui convient, le récepteur peut aussi les ouvrir sous forme de document (image, son, vidéo) ou les exécuter en tant que programmes.
Société d'édition de logiciels éducatifs, de divertissement et d'information, fondée en 1980. Elle a acquis sa popularité grâce au logiciel éducatif "Mavis Beacon". Rachetée une première fois par Software Country, en 1986, pour fonder The Software Toolworks, elle est de nouveau rachetée, en 1994, par le groupe multimédia Pearson et rebaptisée Mindscape.
Mindscape, c'est aussi Atreid Concept, Société française rachetée en 1994 et qui développe des logiciels de jeux et d'animation en 3D, Strategic Simulations, rachetée en 1994 et elle aussi spécialisée dans les logiciels de jeu, ou encore MicroLogic, rachetée en 1995.
Mindscape est, par exemple, l'éditeur des jeux Chessmaster 5000, MegaRace et Azrael's Tear.
Ingénieur américain (1932-1994). Il est le créateur de l'Amiga 1000, en 1982, qui fut exploité par la Société Commodore, en 1985.
Nom donné à un lecteur de bande pour PC, de conception simple, qui fonctionnait avec des cassettes audio ordinaires. Le PC IBM de 1981 possédait encore un connecteur pour magnétophone. Ce mode de stockage de données a, depuis, été complètement supplanté, dans le secteur ordinateurs personnels, par le lecteur de disquettes.
Les MiniDisc (MD) sont une nouvelle génération d'appareils pour l'enregistrement et la lecture de données audio numériques, introduits par Sony en 1992. Ils utilisent des disques de 2,5 pouces avec un procédé d'enregistrement et de lecture magnéto-optique. Ils sont censés remplacer la cassette compacte conventionnelle dans le domaine de la hi-fi. La capacité de stockage limitée des MiniDisc est compensée par une méthode de compression, le système ATRAC. Actuellement, la capacité des MD est de 60 et 74 minutes. La gamme des appareils MiniDisc couvre presque toutes les tailles et tous les prix, allant de lecteurs portables (successeurs du walkman) en passant par les combinés autoradio, jusqu'aux composants de haute qualité pour les chaînes stéréo. Sony prévoit aussi de développer des appareils MD destiné à la micro-informatique. Alors que les marchés européens hésitent, le MiniDisc connaît actuellement un immense succès au Japon. Avec une baisse sensible et attendue des prix des appareils et des supports, la situation va probablement évoluer.
Ce mot désigne les systèmes informatiques de taille moyenne, très souvent compris entre un ordinateur central et un micro-ordinateur.

Magis club de France Telecom
Terminal du système français de vidéotex dont le nom, trouvé par le designer Roger Tallon, symbolise à lui seul la réussite, unique au monde, de cette forme de télématique grand public en France.
Après l'expérience de Vélizy (voir Vélizy (expérience de)), en 1981, la DGT (voir France Telecom) se rendit compte qu'il serait préférable, pour promouvoir l'utilisation du vidéotex, de concevoir un petit terminal spécialisé, plutôt que de proposer un décodeur à brancher sur le téléviseur.
Conçu par le CNET, la division de recherche et de développement de la DGT, et fabriqué par Matra, Telic et TRT, le Minitel 1 vit le jour en 1982. Sa distribution gratuite par France Telecom, justifiée par le fait qu'il s'agissait du nouveau support officiel de l'annuaire des abonnés au téléphone, a été la clé de son succès.
En plus de l'annuaire électronique (le "11", devenu aujourd'hui les Pages Zoom, numéro d'appel "36 11"), de très nombreux services ont été et sont encore offerts dans le cadre du système Télétel.
D'autres modèles de Minitel, plus évolués et à location payante, ont progressivement été proposés : Minitel 2, qui en plus du vidéotex, faisait office de terminal téléinformatique texte ; Minitel 10, équipé d'un téléphone moderne ; Minitel 12, combinaison des M2 et M10; Minitel 5 portable à écran plat. Un des modèles les plus récents, le Minitel Magis, est équipé d'un lecteur de carte à puce et permet les achats à distance.
Les derniers développements prévus, le Minitel Photo, de qualité d'image bien supérieure, complété du nouveau réseau Télétel Vitesse Rapide, n'ont pas réellement porté leurs fruits. Face à l'explosion de l'Internet et du World Wide Web, sorte de vidéotex de très grande qualité d'image à l'échelle mondiale, l'avenir du Minitel et de Télétel paraît incertain.
Mathématicien, musicien, théoricien, Marvin Minsky est considéré comme l'un des pionniers de l'intelligence artificielle. Au début des années 50, ses premiers travaux développent une relation mathématique entre la science cognitive et l'informatique (qu'on appelait alors cybernétique). En 1961, il fonde, avec John McCarthy, le laboratoire d'intelligence artificielle à l'Institut de technologie du Massachusets (MIT), qu'il dirige jusqu'en 1971.
Au début des années 1970, il formule une théorie intitulée "la Société de l'esprit". Partant de ses observations sur la psychologie infantile et des travaux de ses étudiants sur les "machines intelligentes", il suggère que l'intelligence n'est pas le produit d'un seul mécanisme, mais le résultat de l'interaction gérée d'une panoplie d'agents qui, en se conjugant, conduisent à l'intelligence. Il affine cette théorie au milieu des années 1980. Selon lui, pour qu'un ordinateur pense comme un humain, il faut dépasser la notion de logiciel et imaginer des milliards d'ordinateurs fonctionnant ensemble : sur l'idée primaire de départ, est échafaudé une idée plus complexe, puis une autre, et ainsi de suite. Son livre "La Société de l'esprit" est le résultat de ses travaux sur l'intelligence artificielle.
Programmeur de la famille Atari. Créateur de jeux pour le Commodore VIC 20, il intègre Atari en 1990 et développe Tempest 2000 et Defender 2000.
Il a travaillé sur le microprocesseur Merlin.
Lettre d'imprimerie de petite taille, au dessin particulier, appelée aussi bas-de-casse.
Voir majuscule.
(Abréviation de "million instructions per second") Le MIPS est l'une des unités de mesure retenue lors d'un test de performance. Il indique le nombre d'instructions que l'unité centrale ou CPU peut exécuter en une seconde. Comme les enregistrements de commandes varient beaucoup, la comparaison des valeurs MIPS de différentes familles de processeurs ne donne pas une indication précise de leurs performances respectives.
La marque MIPS est celle des microprocesseurs Silicon Graphics.
Fabricant de matériel informatique allemand spécialisé dans les cartes graphiques, vidéo et son, ainsi que dans les produits de télécommunications (modems et cartes Numéris). Il se pose donc en tant que concurrent de la Société ELSA. Actuellement, Miro se fait remarquer par sa forte expansion sur le marché américain, avec l'apparition de nouveaux produits haut de gamme pour le traitement vidéo. Sur l'Internet, Miro est présent à l'adresse http://www.miro.com.

La page d'accueil de Miro
Opération qui permet d'améliorer la sécurité des données. Les données sont écrites simultanément sur deux disques durs situés sur un même contrôleur de disque dur. Si l'un des disques durs tombe en panne, les données ne sont pas perdues (voir aussi RAID).
Les logiciels (voir logiciel) sont continuellement développés et mis sur le marché à intervalles irréguliers avec un numéro de version plus élevé, en tant que "mises à jour". Pour réduire les coûts demandés aux utilisateurs enregistrés, les constructeurs proposent des mises à jour à un prix nettement avantageux.
Pour acquérir la mise à jour, la preuve de possession de la licence peut prendre diverses formes : certains constructeurs demandent la première page du manuel et le numéro de série, d'autres font vérifier par le programme mis à jour l'existence d'une version du programme plus ancienne. Ce qui importe réellement est que l'ancienne et la nouvelle version ne travaillent pas en parallèle sur un ordinateur et que l'ancienne version ne soit ni réinstallée sur un autre ordinateur ni revendue.
Désigne la réduction ou le grossissement des caractères sur imprimante ou sur moniteur. Ce n'est généralement possible que pour les caractères représentés par une image en mode vectoriel.
On peut procéder à une mise à niveau du processeur lorsque le fabricant de la carte mère a prévu la possibilité de remplacer ultérieurement le processeur par des modèles plus rapides. Une mise à niveau du processeur permet d'améliorer les performances de calcul de l'ordinateur. Le processeur n'est plus directement soudé sur la carte mère, mais emboîté dans un socle ; il suffit alors de le changer simplement.
La mise en commun des deux canaux B (voir canal B) d'un accès de base à Numéris permet d'atteindre un taux de transfert des données de 128 Kbit/s, ce qui est particulièrement intéressant pour la vidéotransmission et les systèmes de vidéoconférence.
En activant simultanément une compression des données, le taux de transfert peut même atteindre les 300 Kbit/s. Les frais de communication sont également doublés ; cette pratique ne sert donc pas à économiser de l'argent, mais du temps. Sous Windows 95, la mise en commun des canaux avec le service d'accès distant n'est possible que si l'ensemble MS ISDN-Accelerator-Pack 1.1 est installé. Il est téléchargeable gratuitement sur le site Internet de Microsoft.
La mise en forme d'un texte repose sur la mise en forme ou le formatage de ses paragraphes (voir paragraphe). Les paragraphes peuvent être justifiés (voir texte justifié, alignés (voir texte aligné) à gauche, à droite ou centrés et mis en retrait. Il est également possible de modifier l'interlignage à l'intérieur d'un paragraphe et l'espacement des paragraphes.
(En anglais, "layout") C'est la présentation générale d'un document. En PAO, il s'agit plus précisément de la disposition des différents objets et des parties de texte sur une même page. La surface utile d'une page (largeur et hauteur du texte) détermine, avec la taille des caractères et l'interlignage, l'aspect de la page. Les surfaces blanches et/ou tramées contribuent à la perception des différents éléments (voir également traitement de texte). L'un des logiciels de mise en page les plus connus est PageMaker d'Aldus.
Dans les jeux d'action (voir jeu d'action), les simulations (voir simulation (jeu)) et les jeux de rôle (voir jeu de rôle), une mission est une série d'actions que doit effectuer le joueur avec un objectif précis.
C'est un problème de complexité assez moyenne qui a été souvent utilisé pour illustrer les capacités de l'intelligence artificielle et des langages comme Prolog. Il s'agit de faire traverser une rivière à trois missionnaires et à trois cannibales, en ne disposant que d'une seule barque. La règle est que le nombre des cannibales ne doit surpasser nulle part (rive~1, rive~2, barque) le nombres des missionnaires, pour des raisons faciles à comprendre.
(Sigle de Massachusetts Institute of Technology) Le MIT est sans conteste l'université technique la plus renommée et la plus prestigieuse aux États-Unis. Les étudiants et les professeurs de cette Institution jouent un rôle essentiel dans le développement du matériel informatique et des logiciels (voir logiciel) pour tous les types de systèmes.
Voir Negroponte, Nicholas et son MediaLab.
Célèbre hacker, il est connu notamment pour s'être glissé dans le système informatique du Pentagone grâce au réseau ARPAnet ou encore dans celui du laboratoire de recherche de Palo Alto de Digital Equipment. Le 15 février dernier, il a été condamné à la prison, après son intrusion dans un ordinateur de chez Tsutomu Shimomura.
Constructeur japonais, Mitsumi produit principalement des lecteurs de disquettes et de CD-ROM. La Société s'est surtout fait connaître avec des lecteurs CD-ROM bon marché. Actuellement, elle élargit sa gamme avec le développement de graveurs de CD (voir graveur de CD-ROM) dotés de l'interface ATAPI et de nouveaux lecteurs de disquettes d'une capacité de 130 Mo. On le trouve sur l'Internet à l'adresse http://www.mitsumi.com.

La page d'accueil de Mitsumi
Procédé de compression utilisé dans le contexte du montage vidéo. Contrairement à MPEG, chaque image numérisée est compressée et enregistrée individuellement. Voir aussi JPEG et compression de données.
(Abréviation de "memory-management unit", unité gestionnaire de mémoire) Unité du matériel, le plus souvent intégrée au microprocesseur, qui aide à gérer la mémoire.
Depuis la sortie du processeur 386, les processeurs de la famille Intel 80 x 86 comprennent une MMU.
Désigne les processeurs (voir processeur (matériel)) incluant un jeu de 57 instructions supplémentaires destinées à permettre l'accélération des traitements (affichage 2D et 3D, vidéo, reconnaissance des formes, etc.) et qui portent le nom de fonction DSP.
Le gain de performance est réel avec des améliorations de 50 à 400 % selon les applications.
Les nouvelles instructions sont basées sur l'architecture Simd (Single instruction multiple data) : une seule instruction traite en parallèle plusieurs données.
Intel propose en 1997 ses premiers multiprocesseurs MMX.
Un procédé mnémonique ou mnémotechnique est une méthode permettant de retenir plus facilement des informations. Elle se fonde sur l'association d'idées. Dans le domaine de la programmation, on utilise un tel procédé pour associer un nom (appelé mnémonique) à une instruction en langage machine, ce qui facilite la programmation en code assembleur.
Voir mnémonique.
(Abréviation de "Microcom Network Protocol") Désigne une série de protocoles de transmission (voir protocole de transmission) par modem. Ils ont été produits par la compagnie Microcom et repris comme norme par les autres fabricants. Le CCITT les a ensuite recommandés. Les MNP-4 sont encore assez importants dans le domaine de la détection et de la correction d'erreurs. Les MNP-5 servent à compresser les données, ce qui accroît énormément le débit de transmission. Le protocole reconnaît les données qui sont déjà comprimées et n'essaye pas de les comprimer de nouveau.
Voir aussi compression de Huffmann.
(Symbole de "mégaoctet" ; en anglais, MB, "Megabyte") Unité de mesure de la quantité d'informations et de la capacité de mémoire.
1 Mo = 1 024 Ko = 1 048 576 octets (voir octet).
"Énorme" en jargon informatique.
Ce mot peut être utilisé dans des domaines très variés. Il décrit les différents types de fonctionnement d'un écran, d'une imprimante, d'un modem, etc.
Voir aussi :
Dans le standard CD-ROM, on distingue les secteurs en "mode 1" des secteurs en "mode 2" (voir secteur et mode).
Les secteurs en mode 1 sont destinés aux données à risque d'erreurs, comme les programmes et les données, les secteurs en mode 2 étant réservés aux informations moins sensibles.
Les secteurs en mode 1 utilisent, pour la détection et la correction des erreurs, 280 octets de plus que les secteurs en mode 2.
Le mode Cheat, encore appelé "Cheat" ou "code de niveau", désigne la possibilité de simplifier un jeu en entrant un "Cheatcode" (code prédéfini).
Par exemple, dans certains jeux d'action (voir jeu d'action), il est possible d'entrer des cheats pour disposer de vies, d'armes ou de munitions supplémentaires.

Terme qui désigne, au sens strict, le procédé de codage des données utilisé pour stocker celles-ci dans la couche magnétique du support de données (voir disquette, bande magnétique, disque dur, mode).
Aujourd'hui, l'interface parallèle d'un ordinateur ne sert plus qu'à l'imprimante. De nouveaux systèmes d'impression bidirectionnelle et des périphériques comme les lecteurs de disques amovibles (par exemple, le lecteur ZIP) ou les scanners et les caméras numériques se branchent de plus en plus souvent au port parallèle. Ceci demandait une modification du standard existant. IBM fut le premier à introduire une telle mise à jour avec ses ordinateurs PS/2. Le mode LPT, aujourd'hui considéré comme standard, utilise 8 bits, il est bidirectionnel et atteint des taux de transfert des données d'environ 300 Ko/s (à peu près autant qu'un lecteur double vitesse). Pour améliorer la performance, il emploie en outre la technique du "busmastering", c'est-à-dire, la possibilité de transférer les données directement dans la mémoire principale sans faire appel au processeur.
Un groupe de travail, composé des Sociétés Intel, Zenith et Xircom, développa en 1992 le premier port parallèle étendu : le standard EPP (Enhanced parallel port). De nombreux autres fabricants les ont aujourd'hui rejoint. EPP permet des taux de transfert de données jusqu'à 2 Mo/s, à peu près équivalents à la vitesse d'un réseau ou d'un disque dur lent. Pour pouvoir utiliser EPP, il faut toutefois être équipé de câbles spéciaux. L'interface elle-même doit être dotée de commutateurs adéquats. Il n'est pas possible de mettre à niveau des interfaces de ports parallèles existants. Cependant, EPP est entièrement compatible en aval ; des imprimantes conventionnelles peuvent être branchées sans problème. Dans l'autre sens, il est possible d'adresser jusqu'à 64 périphériques EPP externes à la même interface rendant obsolète l'utilisation de commutateur. Fin 1992, Hewlett Packard et Microsoft ont défini une nouvelle mise à jour encore plus puissante, le standard ECP (Extended Capability Port). ECP a des caractéristiques semblables à EPP, mais possède en plus un contrôle FIFO. Grâce à la mémoire tampon FIFO intégrée, les données échangées peuvent être stockées, comme avec les ports série. Cette technique évite de perdre des données, par exemple si le processeur est momentanément occupé par un accès au disque dur. ECP permet aussi de contrôler le taux de transfert en fonction de défaillances (par exemple, à cause de câbles défectueux) et de corriger d'éventuelles erreurs. On peut adresser jusqu'à 128 périphériques externes avec leur propre identification ; une fonction supplémentaire de compression des données RLE augmente les performances.
Les cartes mères (voir carte mère) récentes de 486 et de Pentium prennent généralement en charge tous les ECP et EPP.
Le mode de l'interface parallèle est commuté dans le BIOS de l'ordinateur. Il faut cependant dire que très peu de périphériques exploitent ces capacités étendues. La plupart des imprimantes récentes sont compatibles (certes, en mode bidirectionnel) et utilisent quelques-unes des capacités d'ECP et d'EPP. Mais pour une impression simple, le mode standard LPT est suffisant. Il en va différemment lorsque l'on branche au port parallèle des lecteurs de disques amovibles (comme un lecteur ZIP) ou de CD-ROM. Ici, une mise à niveau vers EPP ou ECP peut entraîner une augmentation sensible de la performance. Le Plug & Play de Windows 95 reconnaît d'ailleurs les modes activés dans le BIOS et installe automatiquement les pilotes appropriés.
L'utilisation d'EPP ou d'ECP n'est pas sans inconvénient. Alors que, pour une simple impression, le mode LPT standard ne requiert généralement qu'une seule adresse de port (voir adresse de périphérique), l'ordinateur réserve, dans les modes étendus, l'un des précieux IRQ (le plus souvent le 7) et un canal DMA (généralement DMA 3).
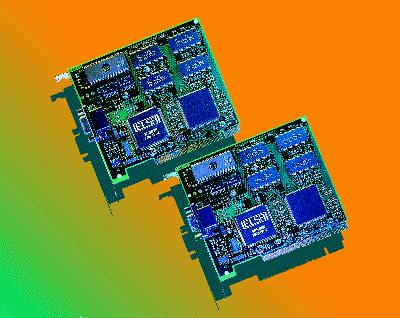
À la différence du mode texte, en mode graphique, chaque pixel de l'écran est géré individuellement. La plupart des cartes graphiques (voir carte graphique) possèdent plusieurs modes (voir mode) graphiques, qui se distinguent par la résolution et le nombre des couleurs.
Le mode multiplex est possible grâce à la technique du multiplexage, technique qui consiste à utiliser une ligne de transmission pour plusieurs tâches simultanées en la divisant en plusieurs canaux logiques (voir multiplexeur). Dans le multiplexage fréquentiel, les canaux possèdent différentes fréquences ; dans le multiplexage temporel, ils sont divisés en petites "tranches de temps" transmises tour à tour.
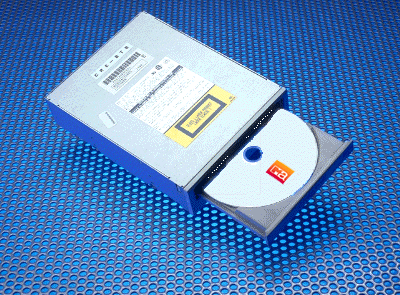
Le mode multisession d'un lecteur de CD-ROM est lié à l'utilisation des CD photo (voir lecteur de CD-ROM, CD photo). Les CD photo pouvant être gravés en plusieurs fois, un lecteur de CD-ROM doit pouvoir lire plusieurs répertoires séparés pour traiter les données.
Capacité d'un système d'exploitation à exécuter simultanément plusieurs programmes. Il est ainsi possible de dessiner en arrière-plan une image fractale, tout en utilisant en premier plan un traitement de texte.
On distingue les modes multitâches coopératif et préemptif :
en mode préemptif, le système d'exploitation alloue le temps de calcul aux programmes s'exécutant en parallèle ;
en mode coopératif, les programmes participants doivent se partager eux-mêmes le temps de calcul.
Un système en mode multiutilisateur peut être utilisé simultanément par plusieurs utilisateurs ayant chacun ses propres tâches et programmes. La capacité du multitâche est primordiale, autant que l'existence de plusieurs postes de travail équipés d'appareils d'entrée et de sortie adéquats (voir terminal).
Voir auto dial.
Dans ce mode, les instructions sont exécutées une par une. De nombreux débogueurs (voir débogueur) fonctionnent en indiquant, à la suite de chaque instruction, le contenu du registre ainsi que le registre d'état. Certains compilateurs (voir compilateur) permettent également (pendant le développement) d'exécuter le programme source pas à pas pour localiser directement une erreur éventuelle.
Mode de représentation d'images par un ensemble de points ou une mappe binaire. Il s'agit en général d'images numérisées par scanner.
Le mode point présente de nombreux avantages, car les images ont une structure simple et offrent une vitesse de traitement et un taux de compression (voir compression de données) élevés. À chaque élément de l'image correspond un point dont les caractéristiques peuvent être modifiées en utilisant un logiciel de traitement d'images (voir logiciel traitement d'images).
L'un des inconvénients majeurs est l'absence de séparation nette entre les différents éléments de l'image, ce qui rend difficile, voire impossible, l'agrandissement ou la réduction d'un seul élément. De plus, l'agrandissement de détails entraîne une diminution de la résolution (voir crénelage).
Le format de fichiers à mappe binaire, désigné
par l'extension.gif">
, correspond au format de fichiers contenant des images (en anglais, "bitmap")
qui peuvent être traitées sous Windows
ou OS/2.
Nom d'un mode de travail performant des processeurs Intel, grâce auquel la mémoire de travail peut être utilisée dans sa totalité, et qui met simultanément les données à l'abri d'un accès concurrent.
Tous les processeurs à partir du 286 disposent du mode protégé, alors que le i8086/88 ne possède, lui, que le mode réel. La quantité maximale de mémoire gérable dépend de la largeur du bus d'adresses. Pour le processeur 80386 et ses successeurs, elle est au moins égale à 32 bits, ce qui correspond à un champ d'adresses de 4 Go.
Voir transmission par rafales.
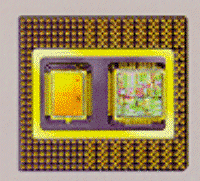
Processeur Pentium Pro
Le mode rafales et pipeline, tout comme le mode continu de transfert sur lequel il se fonde, a fait dernièrement l'objet d'une discussion concernant l'antémémoire de second niveau sur la carte mère des Pentium. L'utilisation de ces deux modes est possible avec les différents types de mémoire vive (voir RAM et SRAM).
Le mode rafales et pipeline consiste en l'exécution coordonnée de plusieurs rafales : de cette manière, un grand nombre de données successives peuvent être transmises plus rapidement, car les adresses ne sont pas transmises individuellement. Avec ce procédé, on ne transmet que l'adresse de début et le nombre d'éléments des données.
Le mode réel était le seul mode d'exploitation des processeurs (voir processeur) 8086 et 8088 d'Intel et le mode de travail habituel du système d'exploitation MS-DOS.
En mode réel, le système d'exploitation, ainsi que tout programme d'application, adresse la mémoire de travail avec les adresses physiques réelles (des parties segment et déplacement). Ces valeurs sont transférées sans autre vérification par le bus d'adresses. En mode réel, code de programme et données se trouvent dans une zone de mémoire unique et ne sont pas mutuellement protégés. Chaque programme dispose en mode réel d'un accès illimité à toutes les ressources du système.
En mode réel, on ne peut adresser que 1 Mo de mémoire. De nouveaux concepts comme EMS et XMS ont été élaborés pour pouvoir utiliser malgré tout plus de mémoire.
Les processeurs modernes d'Intel (du 286 au Pentium) disposent, en plus du mode réel, du mode protégé.

Cette expression s'applique à un modem. On dit qu'il est en mode réponse lorsqu'il accepte un appel et établit la communication en accord avec le modem émetteur (voir mode).

Portable (NEC), Écran couleur
(En anglais, "sleep modus") Ce Mode permet d'appliquer, sur unportable (voir portable (ordinateur)), toutes les mesures d'économie d'énergie, sans perte du contenu de la mémoire principale et des paramètres des programmes actifs.
Il suffit d'appuyer sur une touche pour réactiver tous les composants, et l'ordinateur reprend son travail là où il s'était arrêté.
La plupart des jeux récents comportent un mode réseau qui permet à plusieurs joueurs de jouer ensemble.
Il est souvent possible de choisir parmi plusieurs modes réseau :
a) plusieurs joueurs jouant les uns contres les autres sans adversaires supplémentaires ;
b) plusieurs joueurs jouant les uns contres les autres avec des adversaires supplémentaires ;
c) plusieurs joueurs jouant contre l'ordinateur.
Parmi les jeux les plus connus dotés d'un mode réseau, il faut citer Doom, Command and Conquer, Descent et Warcraft.
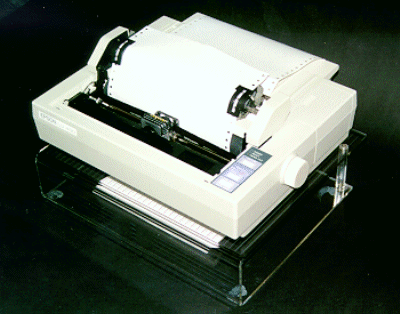
Imprimante à aiguilles
Sur une imprimante à aiguilles, mode d'exploitation qui réduit le niveau sonore de l'imprimante en ralentissant, entre autres moyens, la sortie du papier.
Les cartes graphiques PC, (voir carte graphique) connaissent deux modes fondamentaux :
le mode graphique et le mode texte.
Au début, le mode texte dominait en raison de la faible puissance des ordinateurs - y compris sur le système d'exploitation MS-DOS, avec son interprète d'instructions textuel COMMAND.COM. Il n'existait alors que peu de programmes destinés à l'affichage de graphiques détaillés en mode graphique.
Plus tard sont apparus des programmes et des interfaces graphiques, comme par exemple GEM ou les premières versions de Windows (voir Windows (généralités)). Aujourd'hui leur ont succédé les applications en mode graphique et les systèmes d'exploitation à interface graphique (par exemple, OS/2 ou Windows 95).
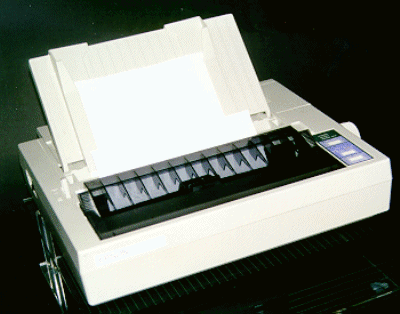
Imprimante à aiguilles
Appelé également "mode brouillon", c'est un mode d'exploitation des imprimantes, notamment de l'imprimante à aiguilles, où la qualité du tirage est réduite au profit de la vitesse d'impression.
Il peut aussi servir à économiser l'encre ou le toner, lorsque l'on imprime fréquemment des documents dont il s'agit simplement de vérifier la mise en page ou le contenu, sans que la qualité d'impression ait une quelconque importance.
On désigne ainsi une manière particulière d'utiliser un modem. Celui-ci doit être équipé d'un microphone et de haut-parleurs. À l'aide d'un programme spécial, le modem peut répondre au téléphone. On dit qu'il reçoit des messages vocaux, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme un répondeur téléphonique (voir mode).
Technique de création plastique du volume.
Un modeleur est soit un outil à sculpter virtuellement des volumes, soit un outil à modéliser des objets virtuels.
Voir modélisation et infographie.
Texte ou format (voir formatage) utilisés comme des documents de base pour des nouveaux textes à produire.
Un modèle peut être, par exemple, un en-tête de lettre avec toutes les indications importantes et l'adresse de l'expéditeur. Après le chargement, on peut ajouter le nom du destinataire et le texte de la lettre. Donc, il n'est pas nécessaire de recomposer l'en-tête de la lettre à chaque fois.
Les modèles peuvent également être utilisés pour des caractères ou des paragraphes individuels. On s'assure ainsi, à l'intérieur d'un document long, un formatage homogène et une possibilité de modification facile, car il suffit de changer le modèle de paragraphe ou de caractères pour changer tous les textes formatés qui l'utilisent.
Voir aussi :
Voir modèle à couches.
Un système important, tel qu'un réseau ou un système d'exploitation, présente de plus en plus souvent une structure modulaire. Afin de réduire le nombre de relations possibles entre les modules, le modèle à couches s'est imposé aussi bien pour la description que pour le développement de systèmes matériels.
Un modèle à couches est composé de différents modules classés selon leurs fonctions dans différentes couches. Ces couches autorisent uniquement les relations entre les modules des couches voisines par l'intermédiaire d'une interface prédéfinie.
Pour préserver la cohérence du système, on établit une structure hiérarchisée composée des différentes couches disposées en anneaux concentriques, c'est pourquoi on parle également de modèle à anneaux.
Dans le secteur de la télématique, les modèles à couches, tels que le modèle à couches OSI, jouent un rôle important. Ils occupent également une place primordiale dans la description et le développement des systèmes d'exploitation, en particulier sous la forme de modèles à anneaux.
Appelé aussi "modèle de référence OSI" ou "ISO", il est développé par l'OSI afin de classer et de définir sur différents niveaux ou couches les principes et les fonctions de la transmission de données dans un réseau, le modèle OSI comporte sept couches réparties en trois couches d'application, deux couches de transport et deux couches de composants matériels.
Les couches d'application contiennent toutes les fonctions relatives à l'ouverture et à la fermeture de session, à la présentation des données et aux fonctions fondamentales de l'application (par exemple, transmission de données et de fichiers). Elles comprennent :
la couche d'application, couche 7 ou couche supérieure ;
la couche de présentation ou couche 6 ;
la couche de session ou couche 5.
Les couches de transport contiennent les fonctions relatives au choix de l'itinéraire (voir commutation), ainsi qu'à l'établissement de la liaison dans le réseau. Elles comprennent :
la couche de transport ou couche 4 ;
la couche réseau ou couche 3.
Les couches de composants matériels contiennent les composants et les fonctions nécessaires à l'exécution physique de la transmission de données, ainsi qu'à sa synchronisation et à sa sécurité. Elles comprennent :
la couche de liaison de données ou couche 2 ;
la couche physique, couche 1 ou couche inférieure.
L'un des principes fondamentaux du modèle OSI réside dans le fait que les fonctions incluses dans une couche donnée ne peuvent accéder qu'aux services qui leurs sont transmis par les couches inférieures, et ne peuvent proposer leurs services qu'à la couche immédiatement supérieure. Cela permet de s'assurer que les composants matériels et logiciels qui exécutent les fonctions d'une ou plusieurs couches peuvent dialoguer avec les autres composants.
Les données, qui sont transmises par une application, et qui passent par les différentes couches, sont réparties en petits paquets de données (voir paquet de données) dont le bloc d'en-tête et le bloc fin contiennent les informations nécessaires à leur acheminement. L'opération inverse est effectuée côté destinataire, où les données spécifiques aux couches sont interprétées pour réassembler le paquet de données complet.
Sur la base des informations spécifiques aux couches, chaque couche d'un ordinateur communique avec la même couche d'un ordinateur distant. Par conséquent, la transmission physique des données se produit uniquement dans la couche inférieure, c'est-à-dire la couche physique. Les règles régissant la communication entre deux couches identiques s'appellent un protocole.
Les réseaux LAN utilisant des technologies agréées par l'IEEE sont conformes au modèle OSI (voir modèle IEEE-802).
Les deux couches inférieures du modèle OSI sont constituées de composants réseau, tels que ceux qui sont utilisés dans un LAN (Ethernet, Token Ring ou ARCnet). Les couches 3 et 4 utilisent des protocoles réseau tels que NetBIOS, IPX/SPX ou TCP/IP. Les couches supérieures 5, 6 et 7, souvent étroitement liées aux protocoles réseau, comprennent les différents composants d'un système d'exploitation réseau ou d'un système d'exploitation doté de fonctionnalités réseau, ainsi que des applications réseau.

Serveur
Il s'agit d'un principe général d'architecture des systèmes informatiques actuels : ils sont équipés d'une série de serveurs (c'est-à-dire des unités chargées d'accomplir certaines tâches) qui se tiennent à la disposition des clients (unités demandeuses).
L'une des caractéristiques essentielles de ce principe est l'autonomie des clients et des serveurs : le serveur offre ses services, qui sont indépendants du client ; le client ne peut demander que les services que les serveurs du système mettent à sa disposition. Une fois que le client a fait sa demande, il n'a aucune influence sur la manière dont le serveur l'exécute (voir modèle).
D'après ce modèle, un réseau d'ordinateurs, par exemple, est donc décrit non seulement comme un certain nombre de machines avec leurs connexions, mais surtout comme une série d'unités logiques avec les services qu'elles offrent ou reçoivent : le rôle d'un poste client est essentiellement d'offrir une interface utilisateur optimale. Il est en effet sans importance pour l'utilisateur de savoir si les données qu'il n'a demandées qu'en les nommant dans son application ont été trouvées localement ou n'importe où ailleurs dans le réseau.
De ces propriétés du modèle client-serveur découlent immédiatement ses avantages : la distribution adéquate des informations, l'intégration puissante de services complexes pour tous les participants grâce à un logiciel homogène, ainsi que la flexibilité et la possibilité de changer de dimensions, en principe illimitées.
Même un logiciel pur, comme un système d'exploitation, peut être structuré selon le modèle client-serveur. Certains composants demandent des services en tant que clients à d'autres composants, qui sont des serveurs.
Les couleurs sont des sensations rétiniennes produites par la lumière : bleu, rouge, violet, vert, noir, blanc, etc., ainsi que tous les mélanges. En physique, on caractérise une couleur par sa fréquence et par la composition de la lumière.
Pour décrire ces sensations visuelles, on a mis au point un certain nombre de modèles de couleurs qui les décomposent en quelques couleurs élémentaires, ainsi que leurs mélanges (voir modèle). Avec le "mélange de couleurs additif", des stimuli sont superposés, comme dans l'œil humain.
En éclairant une surface d'un blanc parfait par des lumières de couleurs différentes, on produit des stimuli simultanés ; on obtient le même résultat en juxtaposant des petits points colorés.
Dans le mélange de couleurs additif, les couleurs élémentaires sont le rouge, le vert et le bleu. Ce processus est à la base des représentations obtenues notamment sur un moniteur (voir écran couleur).
Le mélange de couleurs par soustraction (voir système de couleurs CMY) est le processus contraire et consiste à faire passer, par exemple, une lumière blanche à travers des filtres de couleur successifs. Les trois couleurs élémentaires sont alors le turquoise, le magenta et le jaune.
Pour l'impression multicolore, on utilise généralement une combinaison des deux processus.
Voir modèle à couches OSI.
Modèle de document spécialement créé pour la rédaction rapide de télécopies. Voir modèle
Modèle développé par l'IEEE, en conformité avec le modèle à couches OSI, et se rapprochant des fonctionnalités d'un réseau local Voir LAN
Il est conforme aux normes relatives aux couches OSI 1 et 2, la couche physique et la couche de liaison. Pour représenter avec précision les relations dans un réseau local, la couche de liaison a été divisée en deux sous-couches :
1. La sous-couche inférieure MAC (Media Access Control) autorise l'accès général de l'ordinateur à la couche physique et donc au câble réseau.
2. La sous-couche supérieure LLC (Logical Link Control) veille à la fiabilité de l'échange de données.
Les normes IEEE relatives aux sous-couches MAC et LLC sont venues compléter la technologie réseau Ethernet et Token Ring.
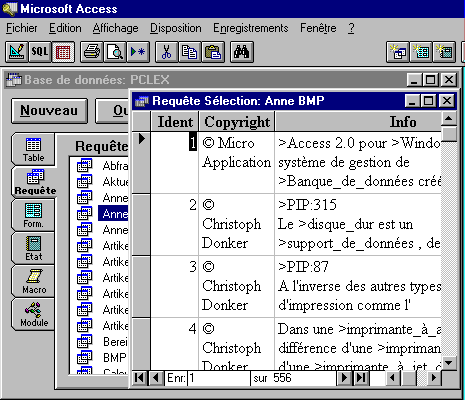
Le modèle relationnel (voir modèle)d'une base de données relie différents tableaux par des champs de clé définis. On peut ainsi représenter dans un tableau (voir tableau (bureautique)) les adresses des clients et, dans un autre, leurs comptes ; les deux sont reliés par le champ numéro de client. De cette manière, on peut économiser de la mémoire, puisque les données n'ont pas besoin d'être copiées, on évite leur redondance (apparitions multiples des données) et leur incohérence (apparitions différentes des mêmes données).
Actuellement, les programmes des bases de données utilisent beaucoup le modèle relationnel.
Certains logiciels de base de données relationnelle incluentt un module Merise afin d'aider l'utilisateur à concevoir l'architecture de leur base.
Un modèle type est un texte, un tableau, un graphique, etc., utilisé comme modèle pour produire de nouveaux documents (voir traitement de texte). On parle aussi de feuille de style ou de gabarit (voir modèle).
Traduction d'un problème ou d'un objet en concepts mathématiques et en formes géométriques. Voir Mathematica, Matlab, modelage.

(Acronyme de "MOdulateur" et "DEModulateur") Périphérique permettant de transmettre des données informatiques par une ligne de téléphone. On peut ainsi envoyer et recevoir des fax, des données, du courrier électronique et utiliser l'Internet.
Cet appareil transforme les signaux électriques (une série de variations de tension) en signaux électriques analogiques (une série de variations d'amplitude et de fréquences) numériques envoyés par l'interface en série de l'ordinateur (voir interface série). Ces signaux analogiques peuvent alors être transmis par le réseau téléphonique. Ensuite, le récepteur utilise son modem pour les retransformer en signaux numériques.
Le mot "modem" est une contraction de "modulation" et de "démodulation", les deux fonctions remplies par un modem.
Du point de vue structurel, il existe deux types de modems : les modems internes ressemblent à des cartes enfichables qui contiennent leurs propres interfaces en série et n'ont pas besoin d'alimentation extérieure, puisqu'ils sont reliés au bus de l'ordinateur ; les modems externes sont des appareils qui nécessitent une alimentation extérieure et doivent être liés aux interfaces en série de l'ordinateur.
Leur avantage est de pouvoir être utilisés avec un autre ordinateur. Les modems sont généralement équipés de haut-parleurs, de petites diodes de contrôle LED ou même d'afficheurs à cristaux liquides, pour pouvoir présenter les informations clairement.
La vitesse d'un modem peut se mesurer en caractères (baud) par seconde. Un modem à 14 400 bauds (bits par seconde) peut transmettre environ 1 600 caractères par seconde.
Avec leur jeu de commandes AT, les modems (voir modem) de la compagnie américaine Hayes ont établi une norme acceptée dans le monde entier (voir AT (modem)). On dit qu'un modem est compatible Hayes lorsqu'il se conforme à cette norme.
Langage de programmation, fondé sur Pascal, et développé par le même auteur (voir Wirth, Nikolaus). Outre les procédures (voir procédure) de Pascal, MODULA 2 comprend des fonctions supplémentaires destinées au développement de "modules" (d'où le nom du langage). Il s'agit d'un principe fondamental du génie logiciel, qui demande de limiter la portée des variables, des procédures, des constantes, etc. "locales", en les enfermant dans des modules contrôlables, afin d'éviter le conflit avec d'autres entités de nom similaire, mais dont le sens peut être dangeureusement différent (en raison du changement de domaine) ; la compilation indépendante des modules permet également leur éventuelle réutilisation (c'est pourquoi leur structure doit se limiter aux éléments réellement nécessaires et généraux, à l'exclusion des traits dus à un seul et unique problème). À la différence de ADA (dont les modules s'appellent "paquetages" et ont une taille très nettement supérieure), MODULA 2 est resté un "petit" langage (par exemple, le temps réel est traité de manière classique), ce qui explique en partie sa diffusion restreinte, à vocation plutôt pédagogique.
MODULA 2 est disponible pour MS-DOS et OS/2, ainsi que pour Macintosh.
C'est l'une des fonctions du modem : les données digitales sont transformées en signal analogique afin de pouvoir transiter par les lignes téléphoniques.
En transmission de données, le mot "modulation" désigne la création d'un signal sur une porteuse de haute fréquence. Elle s'effectue en agissant sur l'amplitude, la fréquence ou la phase (modulation d'amplitude, de fréquence ou de phase). Le récepteur doit retransformer le message en procédant à la démodulation correspondante (voir modem).
Les ordinateurs personnels sont actuellement construits selon une architecture modulaire. Un "module" est, dans le domaine du matériel informatique, un élément responsable de certaines fonctions internes à l'ordinateur, en association avec d'autres éléments ou avec de grosses unités (par exemple, une carte mère). En raison de sa taille, il peut être remplacé à tout moment par d'autres modules (y compris provenant d'autres fabricants) pour remédier à un défaut ou pour utiliser un module plus performant.
Le disque dur, la carte graphique, le processeur, le contrôleur sont des exemples de modules. On utilise aussi les modules dans le domaine des logiciels. Il s'agit de programmes ou de parties de programmes autonomes qui ne remplissent que des tâches bien définies (voir aussi MODULA 2). Certaines procédures peuvent également être des "modules" (voir procédure).
Voir aussi :
(En anglais, "expansion box") Boîtier servant à accueillir des extensions matérielles qui n'ont pas assez de place dans un agenda (voir station d'accueil)
On appelle "module enfichable" une carte enfichable, dotée d'un boîtier de protection, qui possède un emplacement au sein de l'ordinateur et permet de lui ajouter certaines fonctions.
Entité créée par un assembleur ou un compilateur (voir programme machine) et qui n'est pas encore intégrée à un programme exécutable.
Les modules objets (voir module) comportant des fonctions, des procédures ou des sous-programmes peuvent également être regroupés dans une bibliothèque de modules objets.
Voir programmation modulaire.
En jargon informatique, c'est l'abréviation de "as a matter of fact" (à propos).
Cet effet consécutif à un phénomène apparaît à l'affichage ou à l'impression lorsque deux trames (voir trame) sont superposées. Cet effet peut empêcher l'impression de certaines nuances de gris.
L'effet de moiré apparaît lorsque l'on superpose deux trames tracées sur des feuilles transparentes en les décalant légèrement, ce qui provoque un effet de hachure.
Théoricien français, auteur du célèbre ouvrage "Art et ordinateur", paru en 1971, qui influença toute une génération de pionniers.
Voir art (ordinateur).
Apparue en 1990, la Société Momenta, créée avec l'aide de capitaux-risques, avait pour objectif la mise au point d'un ordinateur sans clavier, concept nouveau et prometteur à l'époque. Pari tenu, puisque la première machine fut disponible au début de 1992. Prototype de ce qui allait devenir une famille de machines sans clavier, dont l'un des rares survivants est le Newton d'Apple, le Momenta a souffert d'une puissance de calcul trop faible pour la reconnaissance d'écriture et la marque disparaît en 1993.

le Pentop de Momenta
En jargon informatique, abréviation de "one moment please" (un instant s'il vous plaît).
Tout ce qui ne fait pas partie du cyberespace.
Ce logiciel de comptabilité permet de suivre ses finances au quotidien et d'établir son budget. On peut protéger son accès par un mot de passe (voir mot de passe (généralités)), les modifications sont enregistrées automatiquement, et il se charge même de rappeler le règlement des factures. Une connexion au Minitel est prévue pour importer directement les données bancaires.
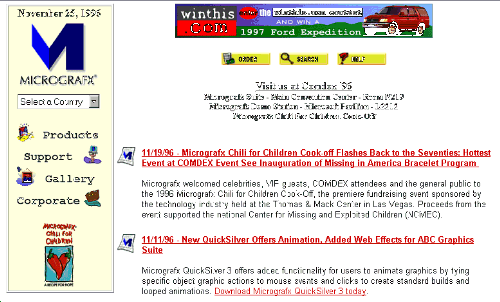
Moniteur Multiscan 20se II de Sony
Périphérique d'affichage, monochrome ou polychrome, de l'ordinateur (voir également écran). Un moniteur est comparable, en principe, à un téléviseur sans récepteur, mais la qualité de l'image y est bien meilleure. Comme pour le téléviseur, un spot lumineux balaye la surface en laissant une trace ; pour les moniteurs modernes, chaque point de l'image est la combinaison de trois points de couleur (rouge, vert et bleu, d'où l'affichage défini en RVB, ou RGB, en anglais, pour red, green, blue). Chaque couleur élémentaire a une intensité différente codée par la carte graphique et déterminant des milliers, voire des millions de couleurs effectives.
Les dimensions des moniteurs sont variables ; pour les comparer, on utilise la mesure de la diagonale exprimée en pouces. On aura donc des moniteurs de 14, 15, 17, 21 pouces...
Une autre caractéristique est sa technologie variable selon le type de grille qui permet de différencier les éléments colorés : on aura ainsi des moniteurs Trinitron aux fentes verticales, des Chromaclear, où chaque point est un ovale, ou des classiques aux points constitués de petits cercles. Le DOT Pitch est la distance minimale entre deux points élémentaires de même couleur et définit donc la précision de l'image : pour un moniteur de 15 pouces le Dot Pitch est de 0,25 à 0,28 mm. Enfin, la fréquence de balayage ou de rafraîchissement donnera une idée sur l'absence de scintillement.
Ce qui importe dans l'utilisation d'un moniteur, ce sont ses paramètres ergonomiques : par exemple, un rayonnement électrostatique et électromagnétique aussi faible que possible. Actuellement, la plupart des moniteurs sont classés à rayonnement faible d'après la norme suédoise MPR.
Dans la mouvance de l'intégration des composants multimédias, dans les PC, des moniteurs ont été développés, qui économisent de la place sur la table de travail grâce à l'intégration du haut parleur dans la structure du moniteur.
Dans le domaine de la programmation, c'est un programme de commande surveillant et contrôlant, en tant que partie d'un système d'exploitation, l'exécution des programmes (voir programme).
Moniteur pouvant restituer diverses normes graphiques à fréquences de lignes et d'images différentes. La possibilité de commutation entre signaux d'entrée analogiques (voir analogique) et numériques (voir numérique) fait également partie de ses caractéristiques.
Voir moniteur.
Moniteurs utilisant le procédé RGB, ou RVB, en anglais, (voir modèle de couleurs) pour afficher les couleurs.
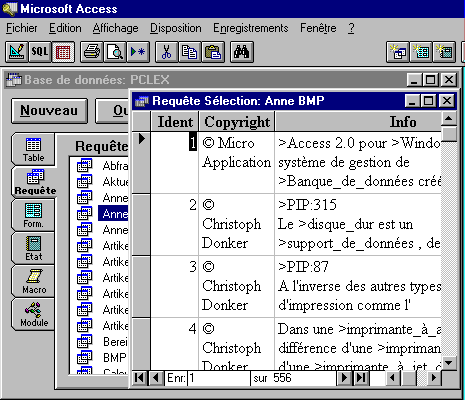
Moniteur Elsa CM-21E112
Un moniteur SVGA est capable d'afficher tous les modes (voir mode) du standard SVGA.
Voir argent électronique.
Voir écran monochrome.
Méthode de montage analogique. Étant donné que les différentes scènes sont enregistrées à la suite sur une bande vidéo, il est nécessaire de rembobiner pour trouver les différents points d'entrée et de sortie. Voir aussi montage vidéo non linéaire
Méthode de montage vidéo informatique rendue possible par la numérisation des images. Les enregistrements se trouvent sur un support à accès direct (par exemple, un disque dur). On peut ainsi accéder directement à n'importe quelle image.
Voir Monty Python and the Quest... et Monty Python's Waste of Time.
Monty Python and the Quest for the Holy Grail est une adaptation du film culte des Monty Python, "Sacré Graal", sur PC, sous la forme d'un jeu très drôle.
Le jeu se déroule sur une douzaine d'écrans qui représentent différentes scènes ou différents personnages. En cliquant en divers endroits de l'écran, on découvre des interactions cachées dans tous les recoins : chaque détail graphique a été exploité et les animations absurdes, les gags visuels ou sonores sont légion. Au fur et à mesure de la progression dans le jeu, des séquences tirées du film sont diffusées. Plus qu'un simple film interactif ou qu'un jeu d'aventures, Monty Python and the Quest for the Holy Grail est une vraie création multimédia originale.
Ce CD-ROM comprend des jeux, des sketches et des outils informatiques créés par cette bande d'acteurs comiques. Le menu principal se présente sous la forme d'un cerveau à partir duquel l'utilisateur peut accéder aux différents domaines. Lorsque le joueur parvient à découvrir tous les secrets des différentes pièces, il accède au "Secret of Intergalactic Success", le secret du succès intergalactique).
Les inconditionnels de l'humour britannique apprécieront certainement ce CD-ROM au contenu très riche.
Ce français est l'inventeur de la carte à puce. Tout commence, lorsqu'en 1974, il a l'idée d'utiliser les mémoires PROM comme instrument financier, en y enregistrant les transactions de manière irréversible et en utilisant les possibilités logiques du circuit intégré. Il va alors créer un terminal, le TMR, et une bague, premier objet portatif supportant les données.
Voir carte à puce.
Transformation progressive d'une image ou d'une forme à l'aide d'un programme spécial, le morphing permet de remplacer le fichier graphique contenant le visage d'une personne par celui d'une autre personne en plusieurs étapes, ou encore de métamorphoser une tête d'animal en visage humain. Les logiciels de morphing sont aujourd'hui si performants qu'ils autorisent des effets très réalistes. Il est également possible de les utiliser pour créer des animations pour la télévision ou le cinéma.
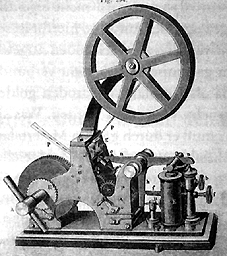
Télégraphe électromagnétique à bande
Peintre américain (1791-1872). Il conçut un alphabet de signes courts et longs, puis, en 1837, une machine qui permettait de transmettre ces signaux au moyen d'un clavier à une touche. Elle envoyait par câble ou par radio des impulsions électriques plus ou moins longues en fonction des lettres à coder et permettait la transmission électrique d'informations. Le morse est aujourd'hui un système international de signes composés de points et de tirets qui servent à retranscrire sur papier le message reçu sous forme de sons courts et plus longs.
Exemple : "SOS" s'écrit en morse ...---...
(Abréviation de "Metal-Oxide Semiconductor"). Désigne un semi-conducteur très répandu et utilisé sous plusieurs formes dans les commutateurs à semi-conducteurs. Les puces MOS se composent d'un corps solide sur lequel ont été vaporisées des couches de métaux et d'oxydes de métaux. Cette technique permet de produire à peu de frais des circuits intégrés de densité moyenne et supérieure. On distingue plusieurs types de puces MOS : NMOS, PMOS, CMOS. Les puces CMOS sont mieux connues du public, car elles servent à l'enregistrement de la configuration dans le BIOS.
(Abréviation de "Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor") Type de transistor très répandu dans les puces MOS à haute intégration. En raison de l'effet de champ, ils sont capables de fonctionner sans électricité.
(Abréviation de "Multimedia Object Transfer Protocol)" Désigne un protocole standard de transmission de services multimédia pour la radio numérique (voir DAB). Il permet de transmettre non seulement des sons, mais aussi des informations supplémentaires (comme des textes ou des images) pouvant être affichées par un récepteur adéquat.
Un groupe de 8, 16, 32, 64 bits, en fonction de la structure du processeur, s'appelle un mot.
C'est un moyen d'identification grâce auquel l'utilisateur obtient l'accès à un ordinateur ou à un réseau. Les mots de passe sont particulièrement importants dans les réseaux, où ils permettent de filtrer les utilisateurs et de sélectionner ceux à qui l'accès aux données est autorisé. Les membres d'un réseau sont identifiés par leur nom et leur mot de passe. Cela permet de leur attribuer des droits différents.
Voir aussi :
Un mot de passe est un mot que le joueur utilise après une mission réussie ou un niveau passé avec succès pour entrer dans le jeu (lorsque il a été interrompu) à l'endroit où il s'était arrêté.
Les mots de passe sont principalement utilisés dans les jeux d'action et les jeux de stratégie (voir jeu d'action et jeu de stratégie) tels que Rebel Assault et Lemmings.
Une fois qu'un ordinateur est mis en marche, le BIOS (dans le cas du PC), et s'il a été configuré pour cela, demande qu'on lui fournisse un mot de passe de démarrage, sans lequel il ne peut pas continuer la procédure. Voir mot de passe (généralités)
Il doit être entré directement au moment du démarrage de l'ordinateur. Le mot de passe système peut être accordé par l'initialisation CMOS (voir CMOS).
Mot utilisé dans la syntaxe d'un langage de programmation particulier et qui, de ce fait, ne peut pas être utilisé autrement (par exemple comme nom de variable). Il s'agit, par exemple, dans un langage comme Pascal, des noms d'instructions ou, pour l'interprète de commandes de MS-DOS, des noms des pilotes des périphériques standard.
En général, le terme "moteur" est utilisé pour désigner les parties d'un programme qui exécutent les tâches fondamentales dans des logiciels d'application. C'est ainsi que la partie d'un programme chargée du rendu graphique s'appelle un "moteur graphique".
Ce terme est également utilisé en relation avec les bases de données. On parle alors de moteur de base de données. Dans ce contexte, le moteur constitue la partie centrale du logiciel de base de données et exécute les tâches de saisie, de gestion et de présentation des données.
Voir moteur de recherche.
Logiciel ou outil permettant de faire une recherche sur l'Internet. En formulant une demande par thème ou par mot-clé, on obtient les adresses électroniques des informations que l'on recherche (voir moteur).

Processeur PowerPC 603
Entreprise américaine, fondée dès 1928. Motorola est l'un des plus grands producteurs de microprocesseurs (en particulier la famille 68000) à architecture RISC et CISC. Ils sont surtout utilisés dans les appareils de la Société Apple (voir Macintosh). Motorola a developpé la puce PowerPC en collaboration avec Apple et IBM.
Voir souris.
Un mouvement spécial est une technique de combat utilisée dans les jeux de combat (voir jeu de combat). Pour exécuter un mouvement spécial, il faut appuyer sur une combinaison de touches ou utiliser différents boutons d'un joystick.
(En anglais, "Multimedia Personal Computer", ordinateur personnel multimédia) Standard, élaboré par les principaux constructeurs informatiques, auquel un PC doit se conformer pour les applications multimédias. Le premier standard MPC1 a été défini en 1991. MPC2, développé en 1993, recommande comme configuration minimale un PC doté d'un processeur 80486 SX (25 MHz), d'une carte graphique VGA HighColor, d'une carte son 16 bits, d'une mémoire vive de 4 ou de 8 Mo et d'un disque dur de 160 Mo.
L'un des composants essentiels est un lecteur de CD-ROM multisession ayant une vitesse de lecture de 300 Ko/s (double-vitesse) au moins.
(En anglais, "Moving Pictures Expert Group") Norme élaborée par le groupe d'experts du même nom. Elle définit un procédé spécial de compression de données pour les images animées (vidéos, animations par ordinateur). Ce procédé de compression est indispensable car le traitement numérique des vidéos produit d'énormes volumes de données, qui ne peuvent pas être gérés par des ordinateurs et des supports de données classiques.
Le procédé MPEG permet d'atteindre un taux de compression très élevé en ne conservant pratiquement que les éléments modifiés dans une séquence d'images.
Les cartes de compression MPEG examinent les séquences d'images des vidéo pour éliminer les images identiques et les données superflues. Pour lire les vidéo codées au format MPEG, il faut disposer d'un décodeur MPEG relativement onéreux, proposé comme solution matérielle ou logicielle.
Comme un décodeur MPEG exige l'utilisation d'un ordinateur extrêmement rapide (au minimum un Pentium 90), les cartes de décodeur MPEG n'ont été utilisées que récemment. À l'avenir, les puces de décodeur MPEG seront intégrées directement aux cartes graphiques, ce qui facilitera la combinaison parfois difficile des images vidéo avec les images produites par la carte graphique. Le procédé de compression MPEG est également utilisé par les CD-Vidéo.

Le MPF 2 de Multitech
(Abréviation de "Micro Professor 2") Commercialisé en 1984 et vendu au prix de 2 000 F, le MPF 2 est l'héritier du MPF 1, lequel se programmait en langage assembleur. Ordinateur d'initiation, il était muni d'un processeur 6502P et comportait 64 Ko de mémoire vive (RAM), une programmation en Basic, un lecteur de cassette et un affichage PAL.
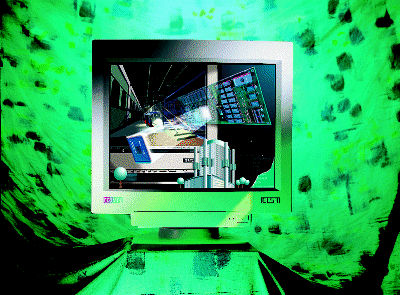
Moniteur Ecomo 20S96 de Elsa
Le Conseil suédois de contrôle et des techniques de mesure (maintenant appelé SWEDAC) a le premier élaboré une recommandation de mesure et de valeurs maximales pour les écrans à basses radiations (voir moniteur). La première recommandation fut appelée "MPR I", et remplacée en 1990 par sa version actuelle, MPR II. La recommandation MPR II indique des valeurs limites pour certaines grandeurs électrostatiques et électromagnétiques devant être mesurées à 50 cm de l'écran, à trois niveaux différents et en 16 points de mesure. MPR II a été reconnue dans le monde entier, et des normes nationales s'en inspirant ont été fixées.
Aujourd'hui, tous les nouveaux moniteurs remplissent au minimum les conditions de MPR II.
(Abréviation de "Micro Processing Unit"). La MPU 401 est une interface standard pour Midi créée par la Société Roland. Lorsqu'une carte son est équipée d'une MPU 401, il est possible d'exécuter des programmes ou de brancher du matériel qui doivent accéder aux fonctions Midi de la carte (par exemple, des jeux avec prise en charge du son Midi ou des synthétiseurs). Elle est particulièrement utile, dans le cas d'une carte son sans fonctions Midi intégrées, lors d'une mise à niveau avec une carte fille Midi. La plupart du temps, il est impossible d'invoquer la carte fille Midi en l'absence d'une MPU 401. À la place d'une MPU matérielle, certaines cartes offrent une solution logicielle sous forme de pilote, mais sans jamais atteindre la large compatibilité nécessaire de la MPU 401.
(Abréviation de "most significant bit") Le MSB est le bit qui a la plus haute valeur dans un octet. Dans le système binaire, le MSB détermine, notamment, si une valeur est positive ou négative.
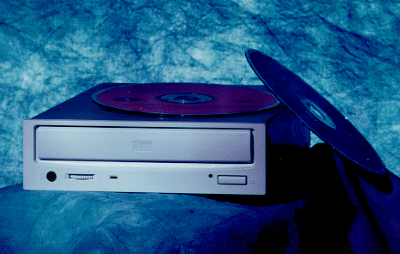
Le fichier MSCDEX.EXE est un pilote (voir driver) de lecteur de CD-ROM sous MS-DOS, intégré au fichier de configuration AUTOEXEC.BAT. Ce pilote permet d'utiliser le lecteur de CD-ROM comme un disque dur.
(Abréviation de "Microsoft Diagnostics") Programme intégré à MS-DOS et Windows (voir Windows (généralités)). Il comporte différents paramètres système, en particulier les paramètres des IRQ (voir demande d'interruption), les adresses des ports d'E/S et les canaux DMA indispensables pour l'installation d'une carte d'extension.
Le programme est lancé à partir de la commande MSD sous DOS.
Le système d'exploitation "Disk Operating System" (DOS), créé par Microsoft, a été livré avec le PC IBM à partir de 1981 sous le nom PC-DOS, puis distribué par Microsoft sous le nom MS-DOS pour équiper une multitude de clones du PC (voir clone).
Ce système a été conçu pour un seul utilisateur. La communication avec l'ordinateur n'est possible que par l'intermédiaire d'un fichier de commandes différées (voir interpréteur de commandes) ou d'un clavier. Il reste pourtant l'un des systèmes d'exploitation les plus utilisés par les PC du monde entier. Il sert de base à d'innombrables programmes, pour toutes sortes d'applications. Il constitue d'ailleurs, jusqu'à Windows 95, la plate-forme de l'interface utilisateur graphique.
abréviation de "message" (voir message (communication)).
(Abréviation de "medium scale integration") La MSI indiquait le degré d'intégration d'un circuit intégré (voir CI), au moment où plusieurs centaines d'éléments ont été réunis sur un seul composant MSI. Voir aussi SSI et LSI.
(Abréviation de Microsoft network) Service en ligne de la Société Microsoft. Conçu dans un premier temps comme un service propriétaire, Microsoft, vu l'évolution du marché, l'a orienté vers l'Internet tout en conservant des services plus spécifiques. Comme tous les autres prestataires de ce type de service (AOL, CompuServe, Infonie, etc.), une tarification horaire est facturée à l'utilisateur.
Voir Microsoft Office.
Voir Windows (généralités).
Voir Works.
Créé en 1983 et opérationnel au début de 1984, MSX est une volonté conjointe de Microsoft Japon et de la plupart des fabricants japonais de lutter contre l'anarchie qui régnait sur le marché des ordinateurs familiaux, au début des années 1980. Le MSX imposait un processeur Z80A, un affichage standard, des interfaces d'entrée/sortie, des connecteurs normalisés, enfin un Basic MSX Microsoft. Selon cette norme, tout périphérique compatible, toute cassette de jeu doivent fonctionner sur un ordinateur MSX, quelle que soit sa marque. Solution fédérative intéressante, mais trop marquée par le Japon, le MSX n'eut qu'un succès mitigé en Europe où les leaders (Sinclair, Oric et Amstrad) continuèrent à se partager le marché.
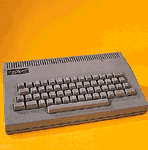
Le modèle MSX128 de Lynx
Cet ordinateur fut commercialisé en 1983 au prix de vente de 3 800 francs. Il devint l'un des nombreux appareils d'initiation des années 1980.
Ses caractéristiques techniques étaient : un processeur Z80 A, une mémoire de 96 ou de 128 Ko, un lecteur de cassettes en standard, un lecteur de disquettes (en option), et un affichage par Péritel.
(Abréviation de "mean time between failures", temps moyen entre les pannes) La valeur MTBF peut être utilisée pour toutes sortes de composants techniques, d'appareils et de systèmes. Elle indique la fréquence statistique des fautes ou des pannes. Il est essentiel de l'indiquer pour un support de mémoire ou pour une mémoire. Par exemple, une MTBF de 10 000 heures fait partie des spécifications de la norme MPC (voir PC Multimédia) pour un lecteur de CD-ROM.
Le CD-ROM MTV Unplugged offre un aperçu de l'émission à succès "Unplugged" à partir d'une liste alphabétique des artistes, quelques courts vidéoclips, ainsi que des informations relatives à la scène qui se déroule sur l'écran et à l'artiste lui-même.
MTV Unplugged comprend également trois vidéos intégrales et inédites.
(Abréviation de "Multi-User Dungeons") Il s'agit en fait d'un jeu vidéo auquel on joue exclusivement online. On évolue dans un univers en temps réel, selon les actions des autres participants.
Les premiers MUD étaient des MUD textuels, un peu comme les premiers jeux d'aventure. Aujourd'hui arrive la nouvelle vague de MUD graphiques avec Meridian 59 (http://meridian.3do.com/meridian/) ou Ultima Online (http://www.owo.com/uo.html).
(En anglais, "multilayer") La technique multicouche est la technologie de fabrication des cartes la plus répandue aujourd'hui. Elle consiste à disposer les uns au-dessus des autres, par un procédé dit sandwich, plusieurs niveaux de circuits. Cette technologie est l'une des conditions de la fabrication de dispositifs électroniques compacts.
Une carte mère, par exemple, possède quatre ou cinq de ces niveaux de circuits, voire davantage.
Version optimisée (1991) du Finder (voir Macintosh). Il permet le multitâche et donc le lancement simultané de plusieurs applications (par exemple Word et XPress).
Les tâches de fond (impression, copier/coller, etc.) sont également exécutables. Les liens entre applications (voir OLE) étaient déjà possibles sous Finder.
Ce terme générique est difficile à cerner car chaque éditeur en a sa propre définition selon les produits qu'il commercialise.
Le multimédia peut être décrit comme une combinaison de textes, d'images, de sons et de commentaires, d'animations, de séquences vidéo, etc. à l'intérieur d'une application sur ordinateur.
On parle aussi fréquemment de multimédia, lorsque deux composants du multimédia sont intégrés à une application. Ainsi, la simple lecture d'un fichier audio est parfois considérée comme étant du multimédia.
Dans le domaine du matériel, il existe cependant des exigences fondamentales qui doivent être respectées pour qu'un PC puisse être qualifié de PC multimédia.
Au niveau économique, les grands groupes de communication sont de plus en plus axés sur le marché du multimédia.
Ce terme désigne l'utilisation d'un seul médium physique pour plusieurs canaux logiques de transmission qui peuvent transporter des données différentes (voir multiplexeur).
Voir aussi :
(En anglais, "frequency-division multiplexing") Ce processus consiste à diviser un support physique de transmission en plusieurs canaux logiques. Pour cela, on partage toute la largeur de bande du support en plusieurs secteurs de fréquence.
Le multiplexeur assigne une bande de fréquence à chacun des flux de données parallèles devant être transmis, aussi bien pour l'émission que pour la réception. Mais l'étroitesse des canaux ne permet que la transmission analogique (et non la transmission numérique). À côté du multiplexage en fréquence, il existe aussi un multiplexage temporel.
Voir multiplexeur.
(En anglais, "time-division multiplexing") Dans ce mode de transmission, les flux de données provenant de plusieurs sources peuvent être envoyés simultanément sur un seul médium de transmission. Le multiplexeur impose à tour de rôle de petits délais à chacun des flux parallèles à transmettre, une fois à l'expéditeur et la fois suivante au récepteur. Comme chaque flux de données dispose de toute la largeur de bande du média, le multiplexage temporel permet la transmission numérique.
Il existe aussi un multiplexage en fréquence.
Au niveau de l'émetteur, un multiplexeur est un composant ou un appareil qui rassemble plusieurs flux de données parallèles et les distribue dans les canaux logiques appropriés d'un seul médium physique de transmission. Au niveau du récepteur, le multiplexeur permet de séparer les signaux reçus en flux de données parallèles. On emploie parfois le terme "démultiplexeur", dans le second cas. On distingue le multiplexage en fréquence et le multiplexage temporel. Dans la transmission large bande, l'émetteur et le récepteur doivent tous deux posséder un multiplexeur pour que le multiplexage soit possible.
Il s'agit d'un processeur dont la structure interne se compose de plusieurs unités fonctionnelles travaillant en parallèle, et permettant l'application simultanée d'opérations de calcul à plusieurs données. Ainsi, par exemple, il est possible de réaliser des opérations de calcul à l'aide de lignes ou de colonnes entières d'un tableau (voir tableau (bureautique)), composées elles-mêmes, le cas échéant, d'un grand nombre d'éléments.
Voir multitâche.
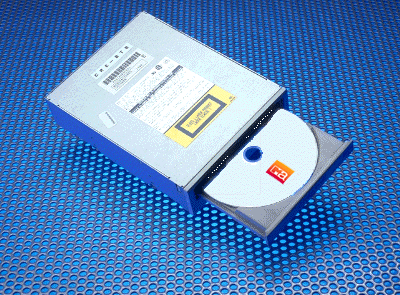
Multisession est le nom d'une technique qui permet de graver un CD-ROM en plusieurs fois.
Appellation utilisée par la Société NEC pour désigner les écrans multibalayage d'une certaine série. C'est aussi le nom employé familièrement pour un moniteur multibalayage.
Le mode multitâche augmente la rapidité d'un ordinateur, car il permet d'exécuter simultanément les tâches ("tasks", en anglais) d'un ou de plusieurs programmes. Comme le CPU perd beaucoup de temps à attendre (les instructions de l'utilisateur et le fonctionnement des périphériques sont lents), on a pensé qu'il pourrait l'utiliser pour effectuer d'autres tâches. En fait, le multitâche n'est pas véritablement simultané, car le processeur ne peut traiter qu'une opération à la fois. Mais les tâches qui attendent sont divisées en petites "tranches de temps" ; le programmateur du système d'exploitation décide quelles sont les tranches prioritaires et les fait exécuter tour à tour quand il y a du temps disponible. Autrefois, les systèmes multitâches ne se trouvaient que dans les ordinateurs centraux ou en mini-informatique. Mais avec Windows 3.1 et 3.11, ainsi qu'avec l'avènement de UNIX, OS/2, Windows NT et Windows 95, ils sont de plus en plus souvent utilisés par les PC. D'autre part, il faut absolument qu'un ordinateur supporte le mode multitâche si l'on veut que plusieurs utilisateurs puissent s'en servir en même temps (les anciens systèmes d'exploitation comme Concurrent DOS permettaient le multi-user sans être véritablement multitâches).
Voir aussi :
Lorsque les ressources, et plus particulièrement les ressources du processeur, sont allouées de façon coopérative, on dit que l'on est en mode multitâche coopératif. C'est le cas, par exemple, avec Windows 3.x (voir Windows (généralités)).
Le programmateur du système d'exploitation est responsable de l'allocation de cette ressource essentielle qu'est le temps de travail du processeur, par exemple sur Windows 95 (voir priorité).
Depuis sa création, en 1971, la Société américaine Multi-Tech est reconnue pour la qualité de ses modems (modem) et de ses multiplexeurs (multiplexeur).
En jargon informatique, cette abréviation de "mung until no good" signifie "détruit intentionnellement".
Il doit sa célébrité à la découverte d'une règle d'application générale que l'on appelle les lois de Murphy.
En 1949, il a effectué pour l'US Air Force des tests visant à mesurer la réaction des êtres humains lors de fortes accélérations. Seize électrodes étaient disposées sur chacune des personnes testées. Lorsque l'on connectait les électrodes, il y avait deux possibilités dont l'une était fausse.
Dans le cas d'une des personnes testées, toutes les électrodes furent mal connectées, ce qui représente une probabilité de 1 sur 65 536. On dit que c'est en apprenant ce résultat que Murphy proposa sa célèbre loi.
Musée d'Orsay-visite
virtuelle
Ce CD-ROM propose une visite du célèbre musée, comme si vous y étiez. Le chapitre "Visite" reproduit en effet les salles actuelles et le champ de vision est de 360. Il suffit de zoomer sur les œuvres exposées. Le chapitre "Collections" raconte l'histoire de l'art de 1848 à 1914, illustrée par 200 œuvres (peintures, sculptures, mobilier, etc.), accompagnées de leur fiche détaillée. Douze récits expliquent les différents courants artistiques. Le chapitre "Album" permet enfin de créer sa pinacothèque personnelle.
Logiciel qui permet de composer ses propres chansons ou d'adapter des chansons célèbres. Music Maker comporte de nombreuses options qui le rendent parfois difficile à utiliser (voir EAO).
Il ne faut pas le confondre avec Music Maker 2.0, qui permet simplement de sélectionner des échantillons parmi une liste, qui en comprend une centaine, et de les arranger à l'aide de la souris sur une grille de huit pistes.
Voir musique électronique.
Musique que l'on produit à l'aide d'ordinateurs, de dispositifs électroniques et de logiciels d'application, en influant par exemple sur les vibrations de fréquences continuellement changeantes, rendues audibles à travers un haut-parleur.
Le PC peut ainsi servir d'instrument de musique, mais aussi de compositeur, de retoucheur de son, ou encore de chef d'orchestre. Voir aussi MIDI et synthétiseur.

Ce CD-ROM permet de réaliser chez soi de la techno, le plus simplement du monde. Musique Techno Studio ne nécessite pas de connaissances préalables dans le domaine de la musique (voir musique électronique). Accessible à tous, son concept est extrêmement simple. Plus de 100 échantillons sonores (fichiers WAV) peuvent être combinés et mixés sur huit pistes. Il est possible de déplacer ces fichiers WAV sur les huit pistes et de les mixer à volonté, par un simple glisser-déplacer.
Le mixage est enregistré de manière dynamique, peut être utilisé ultérieurement comme filtre et placé sur le morceau original. On dispose, en outre, de morceaux chantés et d'instruments combinables à loisir.
En jargon informatique, abréviation de "mind your own business", occupe-toi de tes affaires.
Jeu d'aventures surréalistes vendu par Broderbund. Myst, créé par les frères Miller, est à ce jour le jeu le plus vendu dans le monde. Il se déroule sur une île perdue au milieu de l'océan où le joueur, à la place de la caméra, doit résoudre de nombreuses énigmes (voir énigme) dans un environnement inhabituel et très impressionnant. Voyageant dans l'espace-temps, le joueur reconstitue peu à peu les histoires et les mythes qui firent et détruisirent tour à tour l'île.
Myst se différencie des autres jeux d'aventure du fait de son excellente qualité graphique et image.
Myst II devrait sortir courant 97.